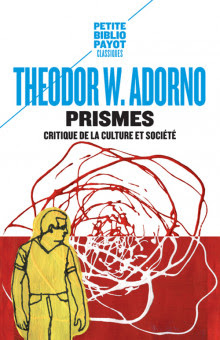Samedi 23 mars 2019
Retour sur Prismes de Theodor Adorno. Plus qu’« un des meilleurs accès à l’œuvre d’Adorno », comme le présente la quatrième de couverture des éditions Payot-Rivages (2018), cet ouvrage est fascinant pour la mise en pratique d’une philosophie. Ou mieux : pour sa pratique philosophique qui ne dissocie pas la théorie de l’action. Véritable praxis. Puisque cette action de penser le monde est une fin en soi, que son objet ne peut être qu’une fin en soi : penser la culture. Dialectique qu’Adorno explicite ainsi : « Aucune théorie, pas même la vraie, n’est à l’abri de la perversion qui la change en délire, dès qu’elle a perdu le rapport spontané avec l’objet. La dialectique doit se garantir tout autant contre une telle perversion que contre le risque de rester prisonnière de l’objet culturel. Elle doit éviter à la fois le culte de l’esprit et l’anti-intellectualisme. Le critique dialectique doit à la fois participer et ne pas participer à la culture. C’est le seul moyen de rendre justice à lui-même et à son objet. » (p.29) On revient souvent sur ce volume de 12 articles et une annexe dont l’unité et la construction sont plus serrées qu’on pourrait le penser, de l’article premier et programmatique à celui sur Kafka, et même à cette annexe sur sa position radicale sur le jazz qu’on lui a tant reprochée (jusqu’à même le bousculer lors de mai 68), qu’on lui reproche encore. Il faut rappeler le fameux constat, le constat terrible qui clôt la première partie : « La critique de la culture se voit confrontée au dernier degré de la dialectique entre culture et barbarie : écrire un poème après Auschwitz est barbare, et ce fait affecte même la connaissance qui explique pourquoi il est devenu impossible d’écrire aujourd’hui des poèmes », auquel il ne faut pas amputer l’explicit qui suit : « L’esprit critique n’est pas en mesure de tenir tête à la réification absolue, laquelle présupposait, comme l’un de ses éléments, le progrès de l’esprit qu’elle s’apprête aujourd’hui à faire disparaître, tant qu’il s’enferme dans une contemplation qui se suffit à elle-même. » (p.30-1) Toujours aussi actuel, quand on a voulu prétendre avoir surpassé l’aporie nazie, quand on veut « sortir du noir » (Georges Didi-Huberman) alors que les conditions économiques, sociales, politiques, sont fondamentalement celles qui ont mis en place le génocide des Juifs, et que ce génocide est loin d’être le seul ! Le problème qui se pose à nous, moins épistémologique et philosophique que simplement quotidien, est le suivant : comment apprécier la culture quand celle-ci dépend de l’industrie (en tant que mode de production capitaliste) et de la financiarisation qui maintiennent notre société déshumanisée ? Baudelaire (qui n’avait pas connu le stade critique du processus achevé par la seconde révolution industrielle et parachevé par la financiarisation de la fin du siècle dernier) avait transcendé une aporie encore marquée du sceau de la morale (mais directement issue de la révolution bourgeoise française de 89) par une production qui exposait sa tare originelle : Les Fleurs du mal. La question peut ainsi évoluer, se décliner, se préciser : comment faire œuvre dans une société où tout œuvre est frappé du coin du mauvais sens ? Comment faire œuvre dans une société désœuvrée ? Walter Benjamin, sans doute, est le père de ces interrogations qui trouvent chez Georges Bataille, à la même époque, une résonance particulière. Maurice Blanchot, puis, encore récemment Jean-Luc Nancy (La Communauté désavouée, 2014), ou même Pascal Quignard (Sur l’idée d’une communauté de solitaires, 2015) ont poursuivi cette voie. En fait ils ont maintenu la question, au sens médiéval (fin XIVe siècle) de « demande faite en vue d’une éclaircissement par la torture », puisque toute position est devenue intenable, et qu’on ne peut plus s’en tenir qu’à des postures. Terme qu’il ne faut pas tout de suite rapprocher de son dérivé « imposture » (surtout dans le sens moral et moralisateur qu’on lui accorde communément) mais plutôt de son acceptation physique, puis artistique – notamment en danse : « position remarquable du corps » (A. Rey). Car c’est bien cette tension qui ne peut plus ne pas caractériser qui veut œuvrer. Mais la première œuvre étant la réception de ce qui nous est dédié, la production qui nous englobe, qui nous traverse, c’est dans la critique (analyse active) de la culture que le premier effort, que la première « torture » (torsion) est sensible. Il faut alors un mouvement d’arrachement à ce qui nous a constitué, un arrachement à notre origine culturelle industrielle. Sans quoi nous participons de ce que nous ne pouvons accepter. Adorno ne semble pas avoir suffisamment considéré combien cet arrachement était tragique. Ou du moins il feint une certaine désinvolture, qui effleure le mépris, quand il n’a pas de mot assez dur pour attaquer le jazz, dans « Mode intemporelle, à propos du jazz ». Sans qu’on le dise, c’est cette dureté de ton, bien plus que la teneur critique, qui lui vaut encore l’hostilité de beaucoup. Son erreur – si erreur il y a – est là : il sous-estime l’impression de révélation sur tout un public – blanc – qu’a été le jazz. Certainement, loin d’être une révélation et un moteur d’émancipation, le jazz a participé en fait à l’anesthésie des consciences qui auraient pu s’élever à la dimension révolutionnaire. Mais au lieu de se concentrer sur ce transfert des pulsions (ce qu’il fait pourtant, aussi, dans un vocabulaire psychanalytique), Adorno s’attarde sur le démantèlement de l’idée suivant laquelle le jazz serait une traduction musicale de l’émancipation, et une émancipation musicale. Quand il s’agit de traiter le problème de l’arrachement (ou plutôt du non-arrachement) des individus à leur jeunesse, à leur intimité (c’est-à-dire ce qu’il y a de plus intérieur, de plus profond), à la découverte, dans leur jeunesse, de leur intimité par le biais de ce qui ne peut pas être maintenu trop longtemps comme une vérité émancipatrice (la musique jazz – mais ça sera, plus tard, la musique rock, puis le punk, puis le hip-hop), il le fait en des termes, justes, mais violents : « Les populations sont à tel point habituées aux niaiseries qu’elles subissent, qu’elles ne veulent pas y renoncer, même lorsqu’elles en sont à moitié conscientes ; au contraire, elles sont obligées de se persuader de leur propre enthousiasme pour se convaincre que l’ignominie est une chance. » (p.155) On peut accepter que le jazz, le punk ou le rap ont été des produits de la industrie culturelle, mais on refusera de remettre en cause les sensations que ces produits nous procurent. Un tel propos attaque ontologiquement bon nombre de personnes : on se construit par ce qu’on consomme, parce qu’on croit être inhérent aux produits de notre consommation. Si on réfute au jazz sa valeur émancipatrice, on ne peut plus que se reconnaître dans l’illusion, dans le mensonge (presque dans la mauvaise conscience sartrienne), non pas dans la posture mais bien dans l’imposture fondamentale, et cela est d’autant plus violent – ou violemment rejeté – qu’elle est inconsciente ou qu’on croit l’avoir dépassé par une conscientisation qui serait incomplète. La blessure est double : on nous prive de notre jeunesse (à l’âge des premiers émois et des premières rébellions), on nous prive de notre « être-libre ». Puisque, en quelque sorte, notre goût pour le jazz ou le punk est le garant de notre pureté conservée malgré nos compromissions avec la société (travail plus ou moins « alimentaire », mariage, enfants, achat d’une propriété, etc). Si même nos garanties de notre liberté essentielle s’avèrent des outils, des appareils de la compromission sociétale, alors il ne resterait plus que les sentiments par lesquels ces genres musicaux se définissent comme émancipateurs par rapport au système : le mépris. Un mépris tourné vers soi-même. Ce qu’on retrouve chez Baudelaire : la déréliction. Si on comprend en quoi le rejet de cette théorie peut se manifester agressivement chez des gens dont le genre musical industriel prône l’agressivité comme meilleur moyen de résistance contre la société (qui, en fait, devient un des meilleurs moyens de résistance contre toute critique opératoire – c’est-à-dire véritablement révolutionnaire – contre cette société), le punk par exemple (mais c’est peut-être encore plus vrai pour le rap dans sa déclinaison gangsta rap – quoique le « gangster » soit, depuis bien longtemps, notamment grâce au cinéma, un personnage reconnu et aimé par la société, tandis que le punk n’y est reconnu qu’en tant que déchet ou, s’il a réussi, « artiste » – Vivienne Westwood parmi d’autres), s’attaquer au jazz a valu à Adorno des soupçons de racisme contre lesquels il a dû se défendre en rappelant (dans l’annexe, p.358-9) qu’il avait été « en grande partie responsable du livre américain le plus discuté concernant le racisme » (The Authoritarian Personality publié en 1950 avec Else Frenkel-Brunswik, Daniel J. Levinson et R. Nevitt Sanford – qui n’est pas disponible en français semble-t-il), qu’il avait été « chassé par Hitler » (argument assez faible, à vrai dire : on connaît beaucoup de massacrés qui massacrent eux-mêmes), mais surtout il avance un argument qu’on retrouve chez Frantz Fanon, dans le titre même de son ouvrage Peau noire masque blanc : « Je n’ai aucun préjugé contre les Noirs, sauf que rien, sinon leur couleur, ne les distingue des Blancs. » Qui se comprend comme une affirmation claire d’une profession de foi non raciste, mais qu’il faut bien sûr pousser un peu plus loin dans la logique comme l’affirmation que tous les individus de la société industrielle sont sujets aux mêmes écueils, et que le jazz n’a pas permis l’émancipation des Noirs, mais leur acculturation (toujours pas totale, au passage) dans la société blanche, les pliant ou voulant les plier aux mêmes soumissions. On pourrait décliner ce principe pour les femmes (comme le font de nombreuses féministes, ou autrices comme Virginie Despentes) : la société ne permet pas l’émancipation des femmes, elle met simplement en place, lentement, difficilement, un processus d’adaptation aux mêmes avilissements que celui des hommes. Égalité dans l’avilissement, voilà le programme de la société dirigée par la Valeur automate.
Dimanche 24 mars 2019
Theodor Adorno, Prismes (suite). Après les réflexions sur le jazz, viennent les réflexions sur Bach, puis l’éloge de Schönberg. « Celui qui ne comprend pas fait comme la haute intelligence de l’âne dont parlait Mahler : il projette son insuffisance sur la chose et la déclare incompréhensible. En effet, la musique de Schönberg réclame dès l’abord une participation active et concentrée ; une attention aiguë à la diversité des événements simultanés ; une renonciation aux béquilles habituelles d’une écoute qui sait toujours d’avance ce qui va se passer ; une perception intense de l’événement singulier, spécifique, et la capacité de saisir avec précision les éléments qui changent souvent à l’intérieur d’un champ infime, et leur histoire unique. La pureté et la ténacité avec lesquelles Schönberg s’abandonnait chaque fois à l’exigence objective le privèrent du succès ; le sérieux, la richesse, l’intégrité de sa musique suscitèrent le ressentiment. Plus elle donne aux auditeurs, moins elle est complaisante à leur égard. Elle demande à l’auditeur de participer spontanément au mouvement interne de la composition ; au lieu d’une contemplation pure et simple, elle sollicite en quelque sorte une attitude pratique. Par là Schönberg déçoit cruellement l’attente, qui subsiste en dépit de toutes les protestations idéalistes, d’une musique se laissant facilement écouter comme une série de stimuli sensoriels agréable. (…) Chez Schönberg, c’en est fini des bons sentiments. Il dénonce un conformisme qui s’empare de la musique comme réserve naturelle de l’infantilisme au sein d’une société qui sait depuis longtemps qu’elle n’est supportable que dans la mesure où elle accorde à ses prisonniers un quota de bonheur enfantin mesuré. Il pèche contre la division de la vie en travail et temps libre ; il réclame pour le temps libre une sorte de travail qui pourrait susciter le doute à l’égard du travail lui-même. Il s’engage passionnément pour une musique dont l’esprit n’aurait pas à rougir et qui par là même fait rougir l’esprit dominant. Sa musique veut s’émanciper à deux extrêmes : elle libère les pulsions menaçantes que la musique n’accueille généralement que filtrées et frelatées dans le sens de l’harmonie ; et elle tend à l’extrême l’énergie de l’esprit, principe d’un moi assez fort pour ne pas renier la pulsion. » (p.184-5) Une suspicion pointe : est-ce que cette déstabilisation de l’attente ne peut-elle pas devenir elle-même une habitude, et un moyen en quelque sorte de se reposer sur l’émotion suscitée par la surprise, de canaliser les pulsions qui par ailleurs existent aussi devant l’inertie de la musique de l’industrie culturelle ? Certaines personnes n’écoutent que de la musique dite « expérimentale », et c’est aussi un moyen de canaliser des puissances qui pourraient se manifester sur le plan politique.