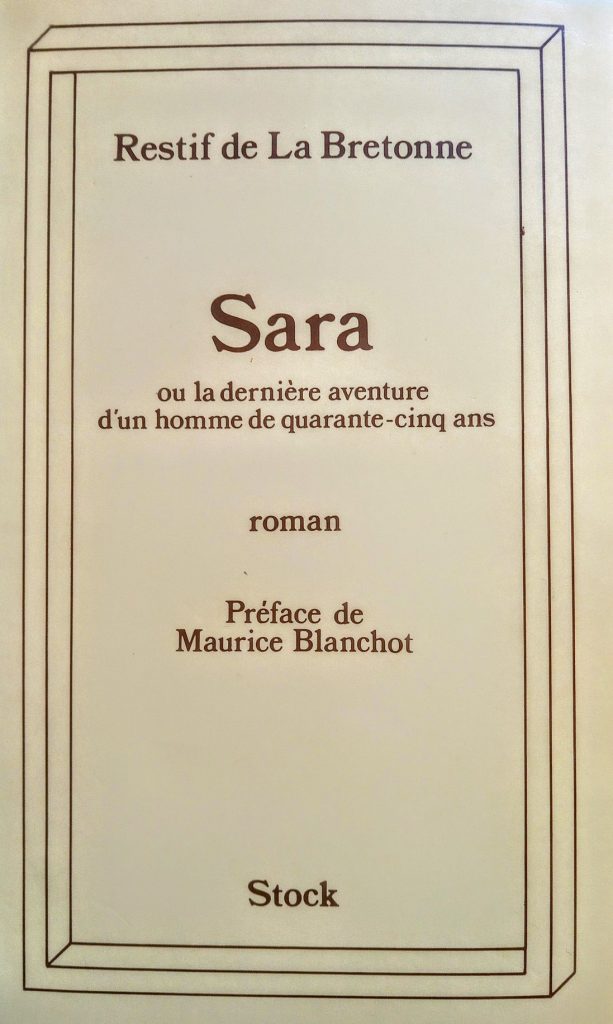
Rapidement, la garrulité et la batterie des battologies de Nicolas Edme Restif de la Bretonne, prêtes de lasser, tournent l’ennui en fascination.
On a souvent comparé Restif de la Bretonne à Sade, son contemporain, on gagnerait à le rapprocher de Proust : même embarras vis-à-vis du temps, même usage de la stratification temporelle qui résout l’embrouillamini par des épiphanies, et même attention sado-masochiste (car qui la victime et qui le bourreau, de Nicolas ou de Sara, de Marcel ou d’Albertine?) à la jalousie, scrupuleusement, et complaisamment détaillée dans ses arabesques les plus tortueux, parfois – avouons-le – les plus barbants. Mais y a-t-il un défaut qui ne se transmute en exquise qualité, par forcènerie ?
Ainsi sa verbomanie, qui est commune à beaucoup, est pourtant sans égale.
« J’écrivis sur la pierre mes tourments » (p.122) Voilà qui est encore plus beau de ne pas être une image.
Cette folie, plus ou moins douce, n’a pas échappé à Nerval qui lui consacre une notice des Illuminés, ni aux Surréalistes. Proust, Breton : les deux fourches d’un pic ancré dans l’Ancien Régime et la Révolution.
Quand l’écriture est un acte de vie.
Cela peut nous paraître étranger. Aujourd’hui, plus personne n’écrit. Quand on écrit, c’est par corvée, ou sur un écran, et, pour la plupart des gens, pour quelques signes avarement comptés. Également faut-il rappeler, sans doute, ces pratiques lointaines et persistantes qui consistaient à écrire son nom ou des vœux sur des fresques dans des églises, dans des chapelles. Il s’en observe aussi bien à Rome qu’à Ravenne, dans les monastères reculés et les plus champêtres sanctuaires. Ceux du XVIe siècle y sont encore lisibles. Fonction performative de l’écriture, si l’on veut, comme Jakobson l’a définie pour la parole. Et certainement autant que la parole est toujours performative, l’écriture ne l’est pas moins, en tant, toutes deux, qu’actions, c’est-à-dire actes physiques. Certes, dans ce cas, non sans superstition : mais n’avait-on pas l’habitude ancestrale de considérer la prière comme performative (autant que nous avons l’habitude de croire qu’un bout de papier peut valoir le nombre imprimé dessus) ? Certains allaient même jusqu’à ingurgiter des pigments de fresque. Plus généralement, quel amoureuse quel amoureux, quel malheureux quelle malheureuse n’a pas gravé un chiffre dans l’écorce ou dans un banc, un nom, un mot, ou sur sa table sordide de classe ou sur les murs des toilettes ?
Mais, dans la pratique monomaniaque, Restif nous surpasse tous. Les gamins de l’île Saint-Louis l’avaient surnommé « le Dateur » (mais des enfants peuvent-ils vraiment attribuer un tel sobriquet en guise de quolibet?) et, dans Sara, il précise (sa franchise complaisante des petits vices le rapprochent de Rousseau – et ce n’est pas à tort que La Harpe le gratifia de « Rousseau des ruisseaux »), par la bouche d’une jeune fille sur le point d’être abusée, qu’on l’appelle « le Griffon ».
« Monstre » est son injure ultime ; celle dont il gratifie Sade (qu’il ne peut cependant, comme un enfant qui se cache les yeux de la main en laissant entrouvert ses doigts, ne pas admirer) quand il atteint l’apax de sa furie. Le griffon est bien une bête monstrueuse. Nouvelle infamie pleine d’esprit pour celui qui griffe la pierre, et presque (nous aimerions le croire) de mémoire involontaire pour un lointain collègue de Sébastien Gryphe (Restif a débuté comme ouvrier typographe, ce qui ne peut que doublement séduire).
Car ce qu’il grave sur les pierres, ce sont des dates. Son époque était particulièrement absorbée par la question du temps. La rigueur scientifique battait en brèche, après la place du Soleil et de la Terre dans l’espace, celle de l’humanité dans le temps : des 5000 ans de la création, on remontait, avec les géologues, à des dizaines de milliers d’années, bientôt à des centaines. Le gouffre s’élargissait. Quand Fabre d’Eglantine concocte son superbe calendrier (hélas abandonné dès le 22 fructidor de l’an XII pour revenir le 11 nivôse à la date du 1er janvier 1806, quand le système métrique eut plus de chance), Restif de la Bretonne élabore son Calendrier à partir de ses amours. Une amante à la place de chaque saint ; plusieurs les jours de fête. Mais, avec ses inscriptions lithiques, Restif de la Bretonne va plus loin : il réconcilie le temps et l’espace. Il échappe, à l’époque même de sa mise en place par la dissociation des tâches (imprimeur-libraire) et les premières machines, à l’industrialisation du livre. Et comment mieux y échapper par ce qui cette ligne de fuite, et cette folie, qu’est l’amour ? L’amour sur une nouvelle cythérée : l’île Saint-Louis. Ce n’est pas tant, semble-t-il, pour persévérer parmi les générations futures (le marbre plus durable que le papier?) que pour ex-pliquer sa propre mémoire, qu’il confectionne cette géographie urbaine sympathique et sentimentale dont se souviendra Cendrars et qui préfigure, d’une certaine manière, la psychogéographie situationniste de Guy Debord et Gilles Ivain.
De sa psychologie, Maurice Blanchot a tout écrit clairement (dans sa préface à Sara qui est par ailleurs et sans ironie son texte le plus drôle) : « la corruption masquée en innocence, les plaisirs pervers de la mauvaise foi, le souci larmoyant de la vertu, ainsi que des manies érotiques, déguisées, elles aussi, en obsessions de propreté, font de Restif un personnage des plus malsains et souvent difficile à apprécier. » (p.27) À cela, il n’y a rien à rajouter. Si ce n’est, encore une fois, que Nicolas n’est pas loin d’un Marcel quand il cherche à emprisonner Sara, véritable victime du vieil homme de quarante-cinq ans, et qui préfigure toutes les courtisanes miséreuses dont le XIXe siècle s’enchantera : les Paquita (La Fille aux yeux d’or de Balzac), les Dame aux Camélias (Dumas fils), les Nana (Zola) ou tel personnage des frères Goncourt qui ne pouvaient que mépriser les toquades sans style du chroniqueur des Contemporaines. Thibaudet ne se trompe pas quand il en fait un des premiers réalistes.
On ne s’attardera pas sur ce qui agace : plus encore que cette mascarade des « fifilles » et des « pépères », finalement drôle à force d’être ridicule et (innocemment) perverse (puisque revendiquée), ou même cette propension à la délation (vérifiée par des documents historiques), surtout l’attrait d’un homme mûr pour une très jeune femme (comme contre-point de l’attirance de Restif pour des femmes plus âgées) et la dépréciation encore une fois presque maladive à force d’être si grossièrement de mauvaise foi de la mère qui en ressort finalement comme la figure de la vengeance féminine face au rejet des hommes (lire le passage avec M. Las, p.229).
Bref, presque un Séverin de Sacher-Masoch à travers masochisme, soumission, avilissement, et volupté dans l’avilissement, ou plutôt un Casanova entre les griffes de la Charpillon (sa décadence à 38 ans à peine), et, un siècle plus tard, un Don Mateo qui, dans La Femme et le Pantin de Pierre Louÿs (1898), met en garde son ami André Stévenol, exactement comme Nicolas prétend mettre en garde d’autres lui-mêmes. Ou encore un « amour insensé », comme tous les véritables amours, tel que nous le décrira Junichiro Tanizaki en 1947.
Car c’est bien, finalement, cette appétence, cette puissance du désir, de la chair, de la beauté physique qui, au-delà de tous les amphigouris axiologiques, transperce dans ce récit. Et c’est ce désir qui libère à tout prix, au prix du crime et de la destruction de soi, qui achève l’oeuvre. Le désir de Nicolas, celui de Sara, celui de la mère, aussi. Sara, forme absolue du futur, comme mot-récit du désir et de la frustration, de la vieillesse et du refus de renoncement.