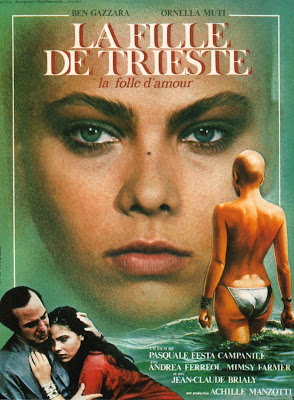Une
tragédie
Ce
film de Pasquale Festa
Campanile, sorti en 1982,
est méconnu – et souvent
déprécié. Pourtant, outre
qu’il est très bon, que
le titre est très beau, il
réunit deux acteurs célèbres,
Ben Gazzara et Ornella Muti.
Y apparaissent également le grand Jean-Claude Brialy dans le rôle
du psychiatre éclairé, Mismy Farmer, Andréa Ferréol ou
encore William Berger.
Seule
la musique, peut-être, a mal vieilli, comme
on dit – mais il faut
l’accepter et dépasser ce qui dans notre goût dépend seulement des
modes actuelles. De plus, cette musique offre en début de film une
légèreté qui, de manière
peut-être voulue, contraste avec ce qui se révèle peu à peu.
Car
ce film est
un drame, – et
même une tragédie. En effet, ce qui se joue n’est pas le seul fait
de la volonté humaine, ce
n’est pas une construction dramatique autour d’une situation
circonstancielle dû à une
organisation ou à des décisions :
ce qui déclenche et fait tenir l’action jusqu’à une fin qui n’est
pas une résolution, c’est l’instinct. L’instinct en
tant qu’amour et en
tant que folie.
On
comprendra alors, même sans l’avoir vu, combien Ornella Muti
est brillante dans ce rôle.
Deux ans auparavant, en 1981, elle incarnait Cass dans l’adaptation
du recueil de nouvelles de Bukowski par Marco Ferreri, Conte
de la folie ordinaire
(le film adopte le singulier pour « conte », tandis que
le recueil bien sûr utilise le pluriel). L’année suivante,
en 1982,
elle apparaissait déjà dans un film de Festa Campanile, Nessuno
è perfetto,
où elle interprétait
(on taxe trop rapidement ce réalisateur de conservatisme) un
transexuel. Dans le rôle de Nicole, elle atteint sans doute un
sommet de l’incarnation cinématographique : beauté à la fois
époustouflante et fêlée, présence enfantine, trouble et
psychopathique,
érotisme à fleur de peau et maladif, plasticité et laisser-aller
le
plus prosaïque.
Cette série de contrastes confine
au
paradoxe, en tout cas évolue
en une
aporie impossible à dépasser. Ainsi, l’amour le plus fou, le plus
passionné, le plus vrai, dont on suit toute l’évolution, lentement,
attentivement, clairement, finit
par se mêler à la folie qui ne
peut être contrainte
ou canalisée
par les personnages – l’amant, les amies, le psychiatre. Cette
folie est
une force qui dépasse l’entendement et les facultés humaines, une
force qui est semblable, si on veut, à l’hybris
d’Œdipe, ou à
la passion de Phèdre. Nicole s’apparenterait à la figure de
Médée,
et à l’ancestrale créature qu’est la
Méduse (cette
fascination qu’elle exerce est sans limite).
C’est la folie, quoiqu’il en soit, qui fait de ce drame une tragédie.
L‘autre
de la folie
Cette
folie n’est pas seulement une folie psychiatrique, une
psychose, une forme de schizophrénie : c’est une folie qui met
en désordre le monde ordonné (l’image du désordre de la chambre
n’est pas seulement un laisser-aller). Comme le dit Valéry, « deux
choses menacent le monde : l’ordre et le désordre ».
C’est en ce sens qu’il faut entendre le désordre de la folie de
Nicole. Elle ne peut pas accepter l’ordre du monde qui la rendrait,
dit-elle, « invisible » : dans le
désordre, c’est-à-dire dans la différence,
elle expérimente immédiatement son être-au-monde le plus pur. Le
plus pur, puisque
cette expérimentation n’a pas d’objet, et n’a pas d’autre objectif
que de persévérer.
La folie de Nicole est un « étant »-au-monde, une
immanence,
et
selon le mot de Bataille, elle est souveraine.
Évidemment
cela ne va pas sans problème, et la conscience sociale de
Nicole aspire
à la tranquillité, à une vie simple et normale (Paris apparaît
comme cette ville de l’ordre). Dans
ces moments de calme, de paix, Nicole cherche à
se faire accepter par les autres.
La
différence devient alors différance
derridienne, puisqu’il s’agit pour Nicole, à la fois de différer
(elle
remet toujours à plus tard, le temps de guérir)
et d’être différente (de ne pas sombrer dans l’invisibilité du
semblable ni
dans la folie).
Limites
de la psychiatrie
Ainsi,
c‘est
aussi, peut-être à contre-cœur, voire
même contre la propre volonté du réalisateur (qui est aussi
l’écrivain du roman qu’il adapte lui-même), le
témoignage de
l’échec – au
moins partiel – du
courant « anti-psychiatrique » de l’Ospedale psichiatrico
provinciale, qui se situait dans le parc San Giovanni à Trieste.
Ce
parc conserve, en plus d’au
moins un bâtiment d’où
les patients peuvent librement sortir et rentrer (et fréquenter
notamment le café – Il
Posto delle fragole –
tout proche de la chapelle),
une si belle et si étrange atmosphère, qui
fait de Trieste cette ville bleue sombre et verte si particulière.
Les
habitants désignent souvent ce
parc comme
le lieu de
l’« ex-OPP ».
Il
y aurait beaucoup à dire sur cet hôpital d’avant-garde, mais qu’on
s’en tienne ici à ce qui fait que le film ne pouvait pas avoir lieu
ailleurs qu’à Trieste : les malades de l’OPP avait la
possibilité de sortir et rentrer quand ils le désiraient,
c’est-à-dire qu’ils étaient libres et pouvaient « descendre »
en ville, ce qui n’est pas qu’une image puisque le parc surplombe
Trieste. Cet élément viendra expliquer des
détails scénaristiques du film qui pourraient paraître farfelus ou
illogiques
(le fait par
exemple
que le psychiatre ne retienne
pas Nicole alors qu’elle est en crise). Ce
qui est dit, en tout cas, est que la folie (une certaine folie)
dépasse nécessairement la portée humaine.
Un
film sur Trieste
Ainsi,
Trieste est le troisième personnage principal de ce film, même si
le nom de la ville n’est
présent que dans le titre. S’il
n’est jamais prononcé, c’est aussi sans doute parce qu’il appartient
à cette folie qui ne dit pas son nom (Brialy explique à Gazzara :
« Ce qu’elle a ? Dépression, névrose, schizophrénie, à
quoi cela servirait-il de donner un nom à ce qui fait que Nicole est
comme elle est ? »). La ville ne se dit pas, mais elle se
voit ; elle ne se dit pas mais elle se parcourt.
Dino cherche Nicole qui a disparu, c’est
un jeu de piste et un labyrinthe.
Nicole est Trieste. Dino
l’esquisse mais elle s’esquive (elle se rase les cheveux). Ville
liée à la folie, celle de Charlotte de Belgique (l’épouse de
Maximilien qui fit construire le château de Miramare – on dit que
les deux s’étaient choisis et qu’ils s’aimaient vraiment, ce qui est
rare à l’époque, et d’autant plus dans ce milieu) ; folie
d’Emilia dans Senilità ;
fous de San Giovanni. Pourquoi la ville est-elle si liée à la
folie ? Est-ce la bora (« le vent de la montagne me rendra
fou », chantait Brassens) ? Est-ce le flou identitaire ?
La Ragazza di Trieste
contribue au
mythe et à la
réalité de Trieste comme
ville qui, contrairement à ce qui se dit avec complaisance, n’est
pas morte en 1918. Ville qui
échappe aux définitions de l’Histoire (les nations, les frontières,
les activités), qui échappe à l’ordre, et dont le désordre est la
fascination et le déséquilibre.