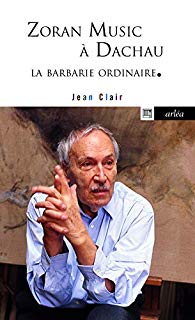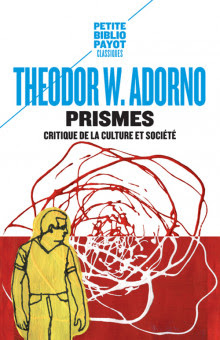La plus grande partie des informations a été puisée dans la
biographie du « Meridiano » publié chez Mondadori sous la direction de
Stefano Giovannuzzi (de courts passages en ont été traduits).
1930 : naissance le 28 mars à Paris. La mère, Marion
Cave, est née en 1896 en Angleterre, et Carlo Rosselli en 1899 à Rome.
La famille s’est réfugiée en France l’été qui suivit la condamnation à
l’exil du père pour ses activités antifascistes. Amelia est le deuxième
enfant : John, le grand frère, est né en 1927. Pour la distinguer de la
grand-mère Amelia Pincherle Rosselli, on la surnomme « Melina ».
1931 : naissance du petit frère, Andrea, après une grossesse difficile qui laisse la mère malade.
1935-6 : séjour d’Amelia et d’Andrea à Florence, chez la grand-mère.
1937 : le 27 mai, Carlo et Nello Rosselli sont
victimes d’une embuscade à Bagnoles-de-l’Orne (où Carlo est en
convalescence pour une blessure reçue pendant la guerre de 36 en
Espagne) par des cagoulards français, vraisemblablement sur l’ordre du
gouvernement italien. La grand-mère, venue en France, emmène Amelia et
Andrea en Suisse rejoindre la famille de Nello. Marion, restée d’abord à
Paris, avec John, part en Angleterre l’année suivante.
1939 : la Suisse refuse de renouveler les visas de la famille, qui s’exile en Angleterre, et se retrouve réunie à Quainton.
1940 : la mère revient en France avec ses enfants, à
Nantes, accueillie par la femme de Louis Joxe (futur secrétaire général
du Comité français de Libération Nationale). Une première attaque
cardiaque la laisse en partie paralysée (elle perd l’usage d’une main et
ne parlera plus qu’en anglais). Quand la France est envahie, Joxe
organise le transfert des Rosselli en Angleterre, par l’Algérie. Mais la
grand-mère, craignant un débarquement des armées allemandes, convainc
la famille de partir aux États-Unis, où ils sont accueillis par Max
Ascoli, professeur juif que Nello avait aidé à s’expatrier en 1931, et
sa femme, des proches d’Eleanor Roosevelt. L’épouse du président leur
obtient des visas.
1941 : la famille s’installe à Larchmont, près de New York. Amelia entre à la Mamaroneck Senior High School de Larchmont.
1943 : la directrice de l’école fait découvrir la
musique à Amelia. Premiers signes de fragilité nerveuse qui inquiètent
toute la famille.
1945 : la fin de la guerre se faisant sentir, la
famille projette un retour en Italie, mais Marion est victime d’un
second arrêt cardiaque.
1946-7 : en juillet, la famille arrive à Florence.
Mais, dès septembre, Amelia repart en Angleterre pour finir ses études à
la St. Paul’s School pour filles à Londres. Elle s’y passionne pour la
littérature, lit les classiques anglais : Donne, Hardy, D.H. Lawrence,
Hopkins, Eliot et Joyce. Mais l’attrait pour la musique est le plus fort
: elle commence à étudier le violon, le piano et la composition, ce qui
déplait à Marion qui voudrait une carrière plus sûre pour sa fille.
1948 : Amelia finit ses études à la St. Paul’s
School et veut se dédier à la musique. Elle est soutenue par John, qui
achève son doctorat à Cambridge. Vacances d’Amelia en Italie. La
grand-mère lui fait rencontrer Luigi Dallapiccolla qui lui enseigne la
composition.
1949 : fiançailles avec Mauro Misul, jeune diplômé
d’histoire et admirateur de Carlo Rosselli. Le 13 octobre, mort de
Marion à Londres. Amelia, qui se sent coupable envers elle, adopte son
nom et signera pendant des années ses lettres privées ainsi que ses
premiers articles « Marion ». Elle décide de rester en Italie, et grâce
aux relations de la famille, elle est prise comme traductrice et
dactylographe aux Edizioni di Communità d’Adriano Olivetti.
1950 : Amelia déménage à Rome, se retrouve dans le
cercle des amis de son père, et commence à fréquenter son cousin Alberto
Moravia, en froid avec le reste de la famille depuis l’assassinat de
Carlo et Nello qu’il n’a pas condamné, proche alors du mouvement
fasciste. Se lie d’amitié avec le peintre Giulia Battaglia, et suit des
cours de composition avec Guido Turchi et Goffredo Petrassi. Se lie
d’amitié avec Roman Vlad et Franco Evangilisti qui est un proche de
Karlheinz Stockausen et de Luigi Nono. Premier article musical sur la
revue Diapason. S’intéresse à l’ethnomusicologie. À Venise, elle
rencontre Rocco Scotellaro avec qui elle lie une forte amitié. Il lui
fait rencontrer ou revoir les amis de son père Manlio Rossi-Doria,
Gaetano Salvemini et Carlo Levi et l’introduit dans l’intelligentsia
romaine : elle rencontre Roberto Bazlen, Renato Guttuso, Giulio Turcato,
Piero Dorazio. Les fiançailles avec Mauro Misul sont rompus. Elle
commence une relation avec Carlo Levi, de presque trente ans son aîné,
qu’elle admet elle-même être une figure paternelle.
1951 : séjours à Paris, chez les Joxe, pour ses
recherches d’ethnomusicologie au Musée de l’Homme. Lit André Breton. En
juillet, écrit My clothes to the Wind, texte le plus ancien repris dans Primi scritti (1980),
où le souvenir de la mère tient une place considérable. Donne à lire
ses premiers textes à Bazlen qui l’encourage, et lui conseille de régler
ses problèmes personnels avant d’écrire : il lui fait connaître Ernst
Bernhard, élève de Jung. Elle s’intéresse à la théosophie, l’alchimie,
la chiromancie, et lit assidument le Yi-King.
1952 : suit les cours de Nicola Perrotti en vue de
devenir psycho-analyste. Commence une analyse de huit mois avec
Bernhard. Fin de la liaison avec Carlo Levi, début d’une relation avec
Mario Tobino, de vingt ans son aîné, qui durera jusqu’en 1955. Continue à
se faire appeler « Marion ». Lit Ezra Pound et Montale, qu’elle
critique, et Campana qu’elle adore. Approfondit ses recherches sur la
musique atonale et le dodécaphonisme. Conçoit et fait même réaliser des
instruments de musiques. S’intéresse de plus en plus à la politique,
proche des positions marxistes.
1953 : s’adonne au dessin (il en reste 99) et à la
peinture, expose au printemps dans une galerie à Florence. Mais la
musique occupe encore la majeure partie de son temps. Mort de Scotellaro
qui marque le début d’une grave crise nerveuse.
1954 : premier électrochoc à la Villa Maria Pia, à
Rome. Transfert au Sanatorium Bellevue de Kreuzlingen, sur le lac de
Constance. Diagnostiquée « schizophrène paranoïaque ». Nouveau
traumatisme, en décembre, avec la mort de la grand-mère.
1955 : en avril, dernière lettre à Mario Turbino, où elle le demande en mariage.
1956 : retour à Rome. Reprend ses recherches
d’ethnomusicologie. Lecture de Miller, Prévert, Svevo, Lautréamont,
Donne. Écrit en italien, en français (Le chinois à Rome), en anglais (October Elizabethans), et dans les trois langues en même temps (ce qui deviendra Diario in tre lingue).
1957 : nouvelles crises, nouvelle hospitalisation à
la Villa Maria Pia. Bernhard conseille de l’envoyer en Angleterre, loin
de l’Italie et de Rome. Le 11 juin, elle est transférée sous sédatif au
Bethlem Royal Hospital, dans le Kent, puis à Coulsdon où elle est
confiée à Rudolf Karl Freudenberg, spécialiste dans le traitement de la
schizophrénie. Le 26 août, elle quitte volontairement la clinique et se
rend chez John. En septembre, elle rentre en Italie. Étudie le piano,
travaille à ses écrits en vue de les faire éditer.
1958 : année intense sur le plan musical et littéraire. Premiers poèmes de ce qui deviendra Variazioni belliche, qu’elle envoie à Einaudi (avec qui elle est en contact pour la réédition des œuvres du père) qui les refuse. Tente d’autres d’éditeurs en vain. Écrit intensément. Nouveau séjour en clinique pendant l’été. S’inscrit au Partito Comunista Italiano (PCI).
1959 : obtient le permis de séjour permanent, mais
pas la nationalité italienne. Activités politiques, littéraires, mais
surtout musicales. Du 25 août au 5 septembre, participe à l’Internationale Ferienkurse für Neue Musik,
à Darmastadt, où enseignent Stockausen, Pierre Boulez, John Cage,
György Ligeti et David Tudor avec qui se noue une liaison d’au moins
deux ans. Stockausen lui promet de l’aider pour ses articles et l’invite
à participer à une conférence pour parler des harmonies et de son
instrument (produit par Farfisa). Collabore pour un spectacle avec John
Cage et Merce Cunnigham. Se produit en concert avec Tudor au Teatro
Eliseo à Rome.
1960 : rencontre, grâce à Bazlen, Giacinta Del Gallo
et Maurizio De Rosa, tout deux peintres. Leur amitié durera jusqu’à sa
mort. Au printemps se rend à Palerme pour les Settimane internazionali
di Nuova musica où elle joue quelques-unes de ses compositions. Passe un
mois à Londres, chez John. S’inscrit de nouveau aux cours d’été à
Darmstadt, mais un nouveau séjour en clinique l’empêche d’y participer.
Période de dépression.
1961 : se consacre intensément au piano. Se rend de
nouveau à Darmstadt. En littérature, l’italien commence à prendre le
dessus. Nouveaux refus auprès d’éditeurs (dont Feltrinelli et Mondadori,
qui lui demande une participation financière, ce qu’elle refuse).
1962 : après avoir vu Accattone, s’intéresse à
Pasolini qu’elle rencontre chez Moravia, mais l’estime mutuelle reste
limitée. Il lui consacrera cependant un article et la mettra en contact
avec Garzanti. Concerts pour le PCI. Se rapproche des studios de musique
de la RAI à Milan, avec une possibilité d’aide financière. Participe au
Pinocchio de Carmelo Bene qui la bouleverse. Collabore avec Bruno
Maderna qui l’encourage dans ses recherches sur la musique électronique.
Elle se produit deux fois avec Sylvano Bussotti dans une galerie, place
d’Espagne, et collabore de nouveau avec Carmelo Bene pour
Spettacolo-concerto Majakovskij. En août séjour en Angleterre pour le
Darlington Music Festival et en septembre à Varsovie. En octobre, entre
en clinique pour subir d’autres électrochocs qui provoquent une perte de
mémoire.
1963 : contacts infructueux avec l’édition française
(avec Guillaume Chpaltine pour « Les Lettres Nouvelles » de Maurice
Nadeau). En septembre, paraissent sur Il Menabò 24 poèmes suivis de la notice de Pasolini. Publication en revue de La libellula (frammento)
en juin. En octobre, participe à Palerme à la première réunion du
Gruppo 63 et à la quatrième Settimana Internazionale Nuova Musica.
Revoie Nono, Stockhausen, Berio, Bussotti. À Rome, collabore de nouveau
avec Carmelo Bene.
1964 : Adolfo Chiesa publie sur Paese Sera un portrait d’Amelia Rosselli avec des bribes d’interviews. Séjour en clinique. Article de Marco Forti dans le Corriere della Sera. En avril paraît son premier recueil : Variazioni belliche.
Peu d’échos dans la presse. Paraissent le même mois huit poèmes
intitulés Serie Ospedaliera, première mention du titre de ce recueil,
dans le revue Le Leader. En novembre, participe à la seconde réunion du
Gruppo 63 à Reggio Emilia, qui donnera 5 poesie per una poetica. Lit Pouchkine, Rousseau, Heidegger, Husserl. Compose la bande sonore d’un documentaire.
1965 : reçoit une bourse du gouvernement pour son
œuvre littéraire, et un projet de loi est présenté pour lui fournir une
pension. Ses conditions économiques sont difficiles, et elle loue une
chambre de son appartement, souvent à des étrangers. Fin juin, mort
d’Ernst Bernhard, et en août de Bazlen. À la recherche d’une situation
économique plus stable, elle entre en contact avec Fabio Mauri qui lui
permet d’obtenir un poste de consultant éditorial pour la littérature,
la musique et les essais chez Bompiani. Continue l’étude du piano et
retourne à la Settimana Internazionale Nuova Musica de Palerme. En
juillet, sur Il Menabò paraissent 15 poèmes de Serie Ospedaliera qu’elle continue à prépare. Travaille à Sleep
pour lequel elle commence à chercher un éditeur en Angleterre, sans
succès. Lit Charles Olson, Emily Dickinson, D’Annunzio. Sur Marcatrè,
revue liée à l’avant-garde, paraît Musica e pittura, dibattito su Doriazio.
À cette époque, la réflexion sur un langage universel, marqué par un
mysticisme platonicien, revient avec insistance. Recherches sur la
lumière et les couleurs. Envoie Serie Ospedaliera à Pasolini puis à Garzanti. Décide de se consacrer à la littérature.
1966 : mort de Vittorini qui a publié le premier des
poèmes de la Rosselli. Vie mondaine et festive. Loue une chambre au
poète Dario Bellezza, avec qui elle entretiendra une amitié ambiguë,
marquée par la jalousie (Bellezza ramène de nombreux amants). Bellezza
lui dédicacera son premier recueil Invettive e Licenze (1971). Il
mourra à peine trois semaines après elle, du sida. Rencontre grâce à
lui les écrivains de l’association Beat 72 : Renzo Paris, Biancamaria
Frabotta, Giorgio Manacorda, etc. Étudie les mathématiques pures, le
dessin, l’acoustique, la composition, et reprend l’équitation. Découvre
l’œuvre de Lorenzo Calogero, à qui elle s’identifie. En février sort sur
Nuovi Argomenti, dans une nouvelle version, La Libellula. Écrit
et détruit frénétiquement. En juin participe à la quatrième rencontre du
Gruppo 63 à La Spezia, qui la déçoit quoiqu’elle y noue de nouvelles
amitiés. Entretient une relation sentimentale troublée avec Renato
Guttuso. Séjour en clinique, vacances à Sperlonga avec Giacinto Del
Gallo et Maurizio De Rosa, où elle écrit les premiers poèmes qui
constitueront Documento. A quelques contacts en Angleterre pour
Sleep sur lequel elle travaille toujours. Les soucis financiers
reviennent : les rapports avec Mauri se dégradent et elle cherche sans
succès un travail chez Einaudi et Licorno. Publie des articles sur
Breton et Pasternak dans Avanti!.
1967 : en avril paraissent 19 poésies intitulées da Documento. Comme Garzanti tarde à publier Serie Ospedaliera, Rosselli cherche un autre éditeur. Le 14 juillet, sur Paese Sera avec qui elle collaborera jusqu’en 1978, sort un article sur le Surmâle de Jarry. Fait une lecture au Teatro del Porcospino à Rome avec Pasolini, Porta et Dacia Maraini. L’événement lui apporte beaucoup et elle décide de la renouveler à la Free Poetry Session du Dioniso Club avec Elio Pagliarani, Patrizia Vicinelli, Valentino Zeichen.
1968 : ne participe pas en personne aux événements de mai
68. Après les échauffourées entre étudiants et policiers Vialle Giulia,
se retire à Camagnano, chez Ferruccio Nuzzo, musicologue, mathématicien
et interprète de Matteo dans le film de Pasolini. Lit Marcuse,
sympathise avec de jeunes militants, dont le futur réalisateur
Gianfranco Fiore Donati. Continue à travailler à Documento. Publie des poèmes et des textes dans Fiera letteraria et le Caffè letterario.
Passe le mois d’août avec Guttuso dans le nord de l’Italie. En automne
travaille sur la réédition des œuvres complètes de Sandro Penna. Le 8
novembre, elle rédige Diario Ottuso qui est le début d’un roman
qui ne verra jamais le jour. Ottavio Cecchi, à la fin de l’année, lui
propose de présenter régulièrement dans L’Unità des revues anglaises et françaises de littérature, politique et sociologie.
1969 : les troubles mentaux s’aggravent, elle se sent persécutée par des voix produites par la CIA, comme elle le racconte dans Storia di una malattia (1977). En été sort Serie Ospedaliera chez Il Saggiatore,
qui remporte le prix Argentario. Après les attentats de piazza Fontana à
Milan (12 décembre 1969) et ceux qui suivirent à Milan et Rome, la
paranoïa empire.
1970 : Garzanti publie Tutte le poesie de Penna, dont
la Rosselli rend compte dans L’Unità. Commence une cure de type holiste
avec Marcello Nardini, notamment pour soigner un début de Parkinson.
Mais les crises paranoïaques continuent.
1971-2 : rompt avec Moravia, Bellezza (devenu rédacteur de Nuovi Argomenti)
et Pasolini (avec qui elle reprendra contact l’année suivante) ; se lie
avec Yuri Maraini, sœur de Dacia, et Elio Pecora, travaille toujours à Documento. Écrit un article sur Sanguinetti, donne des cours de poésie au Teatro femminista della Maddalena, fondé par Dacia Maraini.
1973 : fin de la rédaction de Documento qu’elle imagine être son cinquième et dernier livre. Mais après un tri sévère qui donne naissance à Appunti Sparsi e Persi (publié en 1977), elle renonce à l’idée d’une série close d’œuvres.
1974 : vacances à Maltes avec des amis, puis avec John et sa
femme à Pistoia. Malgré les gênes économiques, elle refuse de toucher
les pensions de guerre qui lui sont proposées. Écrit peu, et sans
enthousiasme. En décembre paraissent 15 poésies de Documento dans Periodo Ipotetico.
1975 : renoue avec Garzanti et Nuovi Argomenti pour qui elle
traduit des auteurs américains, dont Sylvia Plath. Travaillera pour la
RAI à une série d’émissions sur la poésie américaine autre que la celle
de la Beat Generation. Quitte l’organisation du PCI. Le 2 novembre
Pasolini est assassiné.
1976-7 : passe le mois de février et de mars en Angleterre, pour fuir Rome et l’Italie. En avril paraît Documento
chez Garzanti, qui est sélectionné pour le prix Giosuè Carducci. En
mars, vend l’appartement de Rome et en achète un à Londres où elle vivra
jusqu’à l’été 1977. Dès son arrivée, elle est persécutée par les voix
et décide de suivre un traitement aux électrochocs pendant deux mois
dans un hôpital psychiatrique de Londres. Pense au suicide. Revient à
Rome au printemps 77 pour recevoir un prix créé par Elio Pecora
spécialement pour elle, et décide de se réinstaller dans la capitale
pendant l’été. Les jeunes poètes de l’école de Pagliarini lui dédie le
premier numéro de leur revue, Le tigre in corridoio. Se lie d’amitié
avec la poétesse Jolanda Insana. Reprend les études musicales et
ethonomusicologiques. Après une période de calme, avec le retour des
attentats reviennent les voix. Sur Nuovi Argomenti, publie Storia di una malattia.
1978 : elle apparaît dans le « Meridiano » Poeti italiani del Novecento
de Pier Vincenzo Mengaldo, pour Mondadori ; elle y est la seule femme.
Son activité éditoriale devient plus intense : elle publie de nombreux
articles, notamment sur Berryman et Plath. Elle participe également de
plus en plus à des lectures publiques, dans toute l’Italie. En octobre
fait partie de l’équipe fondatrice de la revue trimestrielle Tabula.
Elle y fait publier de jeunes poètes : Alberto Toni, Biagio Cepollaro,
Girolamo Di Costanzo, Gianni Rosati, Pietro Cimatti, Maria Attanasio.
1979 : elle publie October Elizabethans dans le
second numéro de Tabula. Apparaît dans l’anthologie d’Antonio Porta,
chez Feltrinelli, Poesia degli anni Settanta. Rome devient le centre de
référence de la poésie d’avant-garde, et Amelia Rosselli publie beaucoup
et participe à de nombreuses lectures publiques et à des festivals,
dont le Primo Festival Internazionale dei Poeti où elle rencontre
Evtušenko, Ginsberg, Burroughs, Jean-Pierre Faye, Gregory Corso, Amiri
Baraka. Travaille à des projets de traduction et d’édition d’auteurs
étrangers (Jean-Pierre Faye, Joyce, Iris Murdoch). Le 8 décembre, écrit
d’un trait Impromptu.
1980 : dans des lectures publiques féministes, rencontre Rossana Ombres, Armanda Guiducci, Maria Attanasio, Maria Luisa Spaziani, Margherita Guidacci, Gabriella Sica, Biancamaria Frabotta. La revue Braci publie Dario Ottuso. L’attentat de Bologne la bouleverse profondément : pense s’établir en Hongrie. En été, voyage en Espagne. En septembre paraît Primi Scritti. À l’automne, sur Nuovi Argomenti est publié Impromptu, puis l’essai Istinto di morte e instito di piacere in Sylvia Plath.
1981 : la publication chez San Marco dei Giustiniani d’Impromptu lui offre une nouvelle notoriété. Pour l’ensemble de son œuvre, elle reçoit le prix Pier Paolo Pasolini le 27 février. Pour Primi Scritti, reçoit le prix Pozzale Luigi Russo à Empoli. En juin, elle est à Dubrovnik, en juillet à Venise.
1982 : pense de nouveau à vivre à Paris pour
fuir les persécutions dont elle se dit victime. Y passe une semaine pour
le congrès « Femmes et Culture en Italie » (14 juillet) où elle lit Impromptu
qu’elle traduira, ainsi que d’autres poèmes, avec Jean-Pierre Faye et
Jean-Charles Vegliante. Les événements politiques (la guerre des
Malouines, l’invasion israélienne au Liban, la découverte de la loge
maçonnique P2, etc) la touchent nerveusement : elle va jusqu’à demander
la protection de l’ONU, pense de nouveau à partir en Hongrie, en
Bulgarie ou en Algérie.
1983 : Après les élections de juin, contacte le consulat suisse pour demander l’asile politique. Confie Appunti Sparsi e Persi
à AElia Laelia. Emmanuela Tandello la contacte pour une thèse sur la
production trilingue : la collaboration aboutira à partir de 1988 à de
nombreuses traductions et à la publication en 1992 de Sleep. Part dans
le sud (les Pouilles, la Sicile) pour une série de lectures. En
décembre, demande l’asile politique à la Russie.
1984 : obtient le prix Circe Sabaudia pour la poésie. Avec Primi scritti,
est finaliste du prix Camaiore. Participe à plusieurs festivals,
colloques et lectures, dont une rencontre en mai à Genova où elle lit
des textes d’Ingeborg Bachmann. À Rotterdam, participe à un festival de
poésie pour lequel elle traduit le chant V de l’Enfer en français et
anglais. En France, présente la version française d’Impromptu. Court
séjour en clinique à Sienne. Collabore à la traduction en anglais de
poèmes de Raboni.
1985 : Lectures, rencontres. En avril, à Prato, clôture Accenti del vivere,
un cycle de rencontres avec des poètes contemporains, par des poèmes
d’Ingeborg Bachmann. En mai, passe une semaine à Paris pour suivre la
compagnie Altroteatro qui met en scène ses textes. Giacinto Spagnoletti
la contacte pour publier une anthologie de ses poèmes. Elle apparaît en
grabataire lisant Pinocchio dans le film Blu cobalto de Donati. Reçoit
le prix de la Culture du président du Conseil.
1986 : traduction de certains poèmes de Sleep
et publication sur Nuovi Argomenti (mais la revue relègue le texte
anglais en bas de page, ce qui déplaît à la poétesse). Nombreuses
traductions, préfaces, articles, notamment pour gagner de l’argent. En
mai, à Potenza, Ulderico Pesce récite La Libellula. À Florence, au IX Congrès international de la poésie (28 juin – 3 juillet), côtoie Borges, Ghiannis Ritsos, Ted Hugues.
1987 : songe à un voyage à Moscou, écrit qu’elle
attend une intervention de Bush pour trouver une solution à son cas
particulier. Sort Antologia poetica chez Garzanti. Sur I Verri
est publié l’article Serie degli armonici dans sa forme définitive. En
France, Vegliante fait paraître chez La Tour de Babel la traduction d’Impromptu. En août, en Sicile pour recevoir le prix Akesineide avec Bellezza, Beppe Costa, Dante Maffia, Maria Luisa Spaziani.
1988 : retourne en Sicile pour des lectures. À Rome donne un cours de métrique au Laboratorio di poesia
de Pagliarani. Reçoit les prix Minerva et Chianciano (la cérémonie est
retransmise à la RAI). En septembre, avec Gino Scartaghiande, réalise un
voyage à Moscou (1): le rêve d’un asile politique semble prêt de s’accomplir, mais sa demande est retoquée. En hiver, de nouveau en Sicile.
1989 : Lectures en Italie. Paraît Sonno-Sleep
(20 poèmes en édition bilingue), sous la direction d’Antonio Porta,
chez San Marco dei Giustiniani, avec des dessins de Tornabuoni. Le jour
même de la présentation publique du livre, Porta meurt d’un infarctus.
Séjours dans le sud de la France, puis à Paris pour la réédition d’Impromptu. L’Université de Pavie conclut un accord pour acquérir les manuscrits de son œuvre littéraire.
1990 : sur la revue française Banana Split publie des poésies de Sleep en trois langues : Sonno-Sleep-Sommeil. Publication de toutes les proses réunies sous le titre Dario Ottuso (1954-1968) par l’Instituto Bibliografico Napoleone, avec une préface d’Alfonso Berardinelli.
1991 : accord avec Garzanti pour la publication de Sleep avec la traduction d’Emmanuela Tandello. En juillet accompagne Ulderico Pesce qui monte pour le théâtre des Beat 72, Dario Ottuso.
En octobre, se rend à New York pour participer à un colloque sur la
poésie italienne avec ses amis Luzi, Zanzotto, Volponi, Sanguineti.
Reçoit des invitations pour des émissions radiophoniques et
télévisuelles. Suit de près les éditions et les événements qui se
rapportent aux frères Rosselli.
1992 : chez Garzanti, paraît Sleep. Passe deux
semaines chez John à l’occasion de la présentation du livre à Londres.
Obtient le prix Marotta à Naples. Au printemps participe au jury du prix
Città di Recanati. Participe toujours avec assiduité à des rencontres
et des lectures publiques.
1995 : l’éditeur Mancosu réédite Impromptu avec une cassette de poèmes lus par l’auteur. Édition augmentée de Variazioni Belliche par Plinio Perilli pour la Fondazione Piazzolla, avec la Notizia de Pasolini en introduction. Pour le premier numéro de La terra vista dalla luna Amelia Rosselli envoie sa dernière création publiée de son vivant Pavone / Prigione. Au Nuovo Teatro San Raffaele di Roma est mis en scène La Libellula
par Ulderico Pesce avec une musique de Pasquale Laino. Le malêtre
physique et mental se fait plus aigu, mais Rosselli continue de
participer à des événements publics : jury de l’Antipremio Feronia qui
récompense Giulia Niccolai, Rossana Rossanda et J.M. Coetzee.
1996 : réédition de Dario Ottuso par les
éditions Empiria grâce à une collecte de Daniela Attanasio. Début
février, retourne volontairement en clinique. Entre le 9 et le 10
février, menace plusieurs fois de se jeter de la terrasse de son
appartement, mais les voisins parviennent à la dissuader. Le matin du
11, téléphone à Giacinta Del Gallo pour lui dire qu’elle va en finir.
Giacinta accourt, mais il est trop tard, la poétesse s’est jetée dans le
vide. Le soir, elle avait rendez-vous avec Bellezza et le lendemain,
elle devait participer à une lecture sur Apollinaire. Elle venait de
recevoir le prix San Valentino d’Oro. Les funérailles se déroulent à la
Casa della Cultura, elle est enterrée au Cimetière acatholique de Rome.
Note
1. Sur ce voyage, voir l’article : http://golfedombre.blogspot.fr/2009/02/amelia-rosselli-in-urss.html