Auteur/autrice : RKG
For a surreptitious exposure : the art of Illustre Feccia
I say gesture and I mean both the body mechanism in action (how? why?), but also, just a little behind, with the french feminine meaning of the word (la geste) which refers to an epic adventure, combat and (con)quest.
This is the line, – compulsive, generous, maniac (the mania is the dionysian madness that possessed bacchants), which just saturates the surface and inoculates it that expressive density. Since it is through this line, this abundance of features, that the movement arises.
 |
| Mansuetudine Cristiana |
There is a clear maieutic-of-monstruosity process in Illustre Feccia‘s works. It is this process itself – the extraction of a hypogeal life – which is highlighted. It’s not the result that is shown, the dead foetus in its bath of formalin, the teratologic section of the museum, no, it is the whole operation of extirpation of the swarm, with a gap on the pluck, abundant flows, fluids and tissues, in addition to faces and monsters…
 |
| Il bambino che c’è in te |
Its name, Illustre Feccia, somehow, echoes this. Illustre means light, lighting. Feccia refers to the vile matter, the dirty, the excrement (fex, fecis in latin), and that strikes the face – faeces hitting faces – the body and the intellect. It’s clandestine material.
Here, of course, we can connect the movement with its shape, the pattern and the theme, topics and references. It is expressionistic and it is punk. Revolt and social criticism of religions, finance, various coercive powers. This criticism works as a general denunciation of a world where many are starving when others stuff themselves, where free thought is if not punished at least limited, where we stop people from coming where we keep what we have stolen from them… This denunciation works as an extirpation and a highlighting of the profound forces, which are, after all, irrational. For it is irrational: the unreasoned energy (unreasonable?) that enables to prove undoubtedly that some socio-economic realities are unfair, everyone (yes, everyone) is aware of it, that many take offense about it, but finally it does not change and will never change anything (when we begin to want to reason about these unreasonable forces, when we try to reason them, we actually do politics; we don’t : we are in the city: we are politics). This irrational energy, inhuman energy (in the sense that it comes from the human but exceeds him, such as single bee and swarm function differently, or – if we want to divert a Platonic reference – that a limb can’t be compared to the whole body), this energy manifests and figures monsters. And these representations of monsters, (everybody will agree with me on that, at least) are a true treat.
This is yet in another way, in a less superficial manner (how boring is this pseudo-political chatter in the deep squats!), that this gesture is political: through what we call « street art ».
Because the street art (in its best manifestations), we know, is the reclaiming of public space. The surface (the area) is large and flexible: it is no longer in his first architectural function (a wall, a door, a window, etc.), but it is diverted, re-appropriated, by humans. Better: it denounces the hypocrisy and cowardice that were used to build them. And so we can say Illustre Feccia pulls the monstruosity out of the walls.
Video by Jérémy La DjeyDje :
This is the immense work (Grand Œuvre) without lots of means. The artist is no longer limited to the frames, to the canvases, to what it costs (the work is also ephemeral and – more – difficult to recover), to the small surface to which it is constrained by lack of means. He no longer has to canvass the galleries and exhibition spaces, to corrupt himself: he can make the street his own gallery, as did Illustre Feccia under the arches of Deptford, following the Ha’penny Bridge. This may allow him to express himself according to his desire, without recourse to the institutions, without being stamped, retrieved, swallowed, and, in short, denied.
But it would be simplistic to make Illustre Feccia‘s art an art of denunciation, an art – only – of protest (even « beautiful » or « well done ») and even a « dark » art. Since there is also humor, as in this sarcastic figure of a spaghetti eater, and seen that Illustre Feccia (who has lived in London for many years) is Italian, I am tempted to say a Pasolinian humor, or better yet a Boccacian humor, sarcastic and satirical, that delights, as in the Middle Ages, in the pretty vulgarities and beautiful profanities.
But I want to finish on one aspect of his work that I like a lot, which is quite rare and which has perhaps not been explored as well as others: delight & voluptous.
The first work of his I saw was a tribute to Modigliani, which repeated the figure of Luna Czeckowska (1919) that has long been (perhaps still is) my favorite figure by Modigliani (i felt straightaway a strong affinity between us). Her long neck and her blue eyes blurred by swoon…
It is still movement, not underground but submarine. Undercurrents less violent than in the « political » works – but just as intense. Scrolls and convolutions as they exist in beauty – that is pleasure and love. Here, art aspires to a certain harmony, which seeks to reinvent itself, made of nice quirks and intimate depths that flush, again, here and there, on the surface.
« Spring » (which also belongs to this rich magical vein in Illustre Feccia‘s works) is the individuation of this eroticism from the depths: a world of roots, a hypogeous world made monad, a planet (an absolute island) but also as a fragile bubble.
Ariane, in a more classical style, is the Ariane of the Labyrinth, that is to say, the corner, the hidden, the deep away, the Ariane of the « innermost » (« the most intimate, most secret, the deepest – the lower abdomen« ).
This highlightment (the exposure, the uncovering, the baring) is completely opposed to the Society of Spectacle analyzed by Debord and the Situationists. The projecting is opposed to the spectacular, the expression of inner experience is opposed to the entertainment as well as the cathartic event. You could say that we are dealing here with a surreptitious exposure, close to the unlawful, the illegal, the underground.
——–
Christina Rossetti
Christina Rosselli (1830-1894) est née et morte à Londres. Son recueil Goblin Market (1862) est d’une beauté mélodique qu’avait relevé Virginia Woolf. Elle vient d’une famille illustre : son père est le poète italien Gabriele Rossetti, sa mère, Frances Polidori, est la sœur de John Polidori, l’auteur de The Vampyre et l’ami de Byron et de Schelley. Son frère est Dante Gabriel Rossetti.
Nous commençons par traduire une « Chanson ».
Song
When I am dead, my dearest,
Sing no sad songs for me;
Plant thou no roses at my head,
Nor shady cypress tree:
Be the green grass above me
With showers and dewdrops wet;
And if thou wilt, remember,
And if thou wilt, forget.
I shall not see the shadows,
I shall not feel the rain;
I shall not hear the nightingale
Sing on, as if in pain:
And dreaming through the twilight
That doth not rise nor set,
Haply I may remember,
And haply may forget.
Chanson
Quand je serai morte, mon chéri,
Ne chante pas de chanson triste pour moi ;
Ne sème pas de roses sur ma tête,
Ne plante pas de cyprès ombragé :
Sois l’herbe verte au-dessus de moi
Et l’averse et la rosée humide ;
Et si tu veux, souviens-toi,
Et si tu veux, oublie.
Je ne verrai pas les ombres,
Je ne sentirai pas la pluie ;
Je n’entendrai pas le rossignol
Chanter, comme s’il souffrait :
Et je ne rêverai pas dans le crépuscule
Qui ne montera ni ne descendra,
Peut-être je me souviendrai,
Et peut-être j’aurai oublié.
A Tiziana Cera Rosco
De TCR (avec notre traduction) :
In qualunque luogo sarà il corpo
Là si raduneranno le aquile.
Per questo ti dico “Non Tremare”
“Non Tremare” sarà il tuo tuono.
Quando sarai morto, corpo mio,
perfettamente tenero
perfettamente quieto
perfettamente spaccato nel mezzo
Ricordati di me.
Raggiungimi.
N’importe où il y aura le corps
se rassembleront les vautours.
C’est pourquoi je te dis »N’aie pas peur »
»N’aie pas peur » sera ta foudre.
Quand tu seras mort, mon corps,
>parfaitement tendre
parfaitement calme
parfaitement brisé par le milieu
Rappelle-toi de moi.
Rejoins-moi.
*
À Tiziana Cera Rosco
tu es le cep noir et la serpette
un délire de lierre et d’acan
the enserrant mes membres
comme une clé et un disloque
ment car je me suis perdu pendu
à tes vrilles et à tes toupies sur une sur
face de vernis gelée et la pluie
qui ruisselait dessus me brouillait
la vue – épouser ton roulis t’ouvrir
le crâne m’émasculer nu inutile
ment au passage
*
sei di lino e di legno
scuro, anche se mi sembri una chiara
fontana – ti ho pensato un secolo fa
nella foresta e lungo il cratere che inghiottì tutto come il ceppo di vite sei fatta di volute e di voluttà promessa – sei i
rami che crescono dal mio cervello
a volte sono
io il burattino e sei tu
la fata, accerchiarmi, abbracciarti
è l’ora per amare parole
il palindromo della grazia
Note de lecture : « Thérèse et Isabelle », Violette Leduc (1955)
C’est
Virginie Despentes qui, dans King
Kong Théorie
(2006), fait référence à ce livre loin
de son propre style :
« 1948, Antonin Artaud meurt. Genet, Bataille, Breton ;
les hommes font exploser les limites du dicible. Violette Leduc
entreprend la rédaction de ce qui deviendra Thérèse
et Isabelle.
Texte magistral. Beauvoir à sa lecture écrit immédiatement :
»Quant à publier ça, impossible. C’est une histoire de sexualité
lesbienne aussi crue que du Genet. » / Violette Leduc édulcore le
texte, que Queneau refuse aussitôt : »impossible à publier
ouvertement ». Il faut attendre 1966 pour que Gallimard l’édite. »
Le
récit constituait la première partie de Ravages
(1955).
Mais Gallimard
sort le livre amputé de ce passage
(il n’a été publié dans sa version originelle, c’est-à-dire sans
les modifications demandées par Queneau, qu’en 2000).
C’est
le récit d’un amour (où l’emprise physique est précisément
décrite) entre deux jeunes femmes dans un pensionnat.
On le trouve par hasard, on l’ouvre par
curiosité. C’est le choc.
Cette
écriture de l’intériorité, difficile à qualifier, quasi
schizoïdique, qu’on trouve rarement, est
à
chaque fois une
expérience bouleversante.
Neige silencieuse,
neige secrète
de Conrad Aiken
(éditions La Barque),
Sombre Printemps
d’Unica
Zürn,
ou encore La
Mulâtresse Solitude d’André
Schwarz-Bart.
Il
y a une virtuosité de l’écriture qui ne tient pas à l’exercice
mais à un souffle intérieur singulier. Les phrases s’enchaînent
sans qu’on puisse décider si ce sont des images ou des faits :
la parole est si profonde (elle surgit de si bas) qu’elle a quelque
chose d’hypnotique. Il y a une irreconnaissance continuelle de
ces
phrases qui n’ont
pourtant rien de heurté ou de difficile : la lecture, au
contraire, est facile et
envoûtante. Elles
échappent continuellement à ce langage ordinaire construit sur des
formes expressives communes et pré-données. Elles ignorent le lieu
commun, elles ménagent des espaces insolites qui ne sont pas des
refuges, mais des tangentes mobiles et, si on veut, des angles (des
coins) en mouvement. Ce sont des équilibres.
Pour
comprendre – ou se convaincre – de ce que j’avance, il suffit de
lire le
début du texte,
sur lequel
nous finissons
cette note.
De
son importance dans ce qui serait une histoire des représentations
de la femme, de la prise de parole publique (ici littéraire), de la
censure subie, de l’indifférence générale (c’est-à-dire aussi
féminine) sur ces questions, je renvoie à l’essai de Despentes.
« J’errais
à l’écart autour des cabinets. J’entrai. Une odeur
intermédiaire entre l’odeur chimique d’une fabrique de bonbons
et celle du désinfectant des collèges persistait. Je ne détestais
plus l’haleine de la désinfection générale qui nous délabrait
les soirs de rentrée. L’odeur était le rideau de fond avant notre
rencontre. Les cris des enfants fous reculaient. Du siège en bois
clair souvent savonné montait une vapeur : la vapeur de tendresse
d’une masse de cheveux de lin. Je me penchai sur la cuvette. L’eau
dormante reflétait mon visage antérieur à la création de la
terre. Je palpai la poignée, la chaîne, j’enlevai ma main. La
chaîne se balança à côté de l’eau triste. On m’appela. Je
n’osais pas mettre le crochet pour m’enfermer.
—
Ouvrez, supplia la voix.
Quelqu’un
secouait les portes.
Je
voyais l’œil. Il bouchait la découpe dans la porte du cabinet.
—
Mon amour.
Isabelle
arrivait du pays des météores, des bouleversements, des sinistres,
des ravages. Elle me lançait un mot libéré, un programme, elle
m’apportait le souffle de la mer du Nord. J’ai eu la force de me
taire et celle de me rengorger.
Elle
m’attend mais ce n’est pas la sécurité. Le mot qu’elle a dit
est trop fort. Nous nous regardons, nous sommes paralysées.
Je
me jetai dans ses bras.
Ses
lèvres cherchaient des Thérèse dans mes cheveux, dans mon cou,
dans les plis de mon tablier, entre mes doigts, sur mon épaule. Que
ne puis-je me reproduire mille fois et lui donner mille Thérèse…
Je ne suis que moi-même. C’est trop peu. Je ne suis pas une forêt.
Un brin d’herbe dans mes cheveux, un confetti dans les plis de mon
tablier, une coccinelle entre mes doigts, un duvet dans mon cou, une
cicatrice à la joue m’étofferaient. Pourquoi ne suis-je pas la
chevelure du saule pour sa main qui caresse mes cheveux ?
J’ai
encadré son visage :
—
Mon amour.
Je
la contemplais, je me souvenais d’elle au présent, je l’avais
près de moi de dernier instant en dernier instant. Quand on aime on
est toujours sur le quai d’une gare.
—
Vous êtes ici, vous êtes vraiment ici ?
Je
lui posais des questions, j’exigeais du silence. Nous psalmodiions,
nous nous plaignions, nous nous révélions des comédiennes innées.
Nous nous serrions jusqu’à l’étouffement. Nos mains
tremblaient, nos yeux se fermaient. Nous cessions, nous
recommencions. Nos bras retombaient, notre pauvreté nous
émerveillait. Je modelais son épaule, je voulais pour elle des
caresses campagnardes, je désirais sous ma main une épaule
houleuse, une écorce. Elle fermait mon poing, elle lissait un galet.
La tendresse m’aveuglait. Front contre front nous nous disions non.
Nous nous serrions pour la dernière fois après une dernière fois,
nous réunissions deux troncs d’arbres en un seul, nous étions les
premiers et les derniers amants comme nous sommes les premiers et les
derniers mortels quand nous découvrons la mort. Les cris, les
rugissements, le bruit des conversations dans la cour venaient par
rafales.
—
Plus fort, plus fort… Serrez à m’étouffer, dit-elle.
Je la serrais mais je ne supprimais pas
les cris, la cour, le boulevard et ses platanes. »
La langue crue de Verlaine (2/2)
Les voix de Verlaine
Verlaine c’est le multiple, le réversible, le débordant. Sans aucun doute le satyre et le Protée. Peut-être un Janus, même si le réduire à la dichotomie grâce/damnation serait erroné. S’il aime les masques, ce n’est pas pour tromper, ou se cacher, c’est parce qu’il est impersonnel, qu’il est un autre (autant que James Ensor). Cette « impersonnalité » qu’il appelle, qu’il concrétise parfois (Romances sans paroles), qu’il ne perd pas de vue, c’est la sensation d’être traversé par des voix. Les voix divines, les voix maléfiques ; les voix du bon mari, celles de l’amant – des amants, des amantes, celles des amis aussi, celles des sociétés. Mais c’est aussi les voix antiques : Tibulle, Virgile, Horace. C’est Villon, Ronsard, Régnier, Sigogne. C’est Hugo, c’est Baudelaire. Cette impersonnalité, c’est la musique. De la musique avant toute chose évidemment, les « ariettes oubliées », « Les uns et les autres » aussi, c’est le plain-chant des recueils chrétiens (si peu chrétiens), Amour, les Liturgies intimes. C’est le patois, le jargon, celui des faubourgs, celui de Philomène, celui des chansonniers des cabarets fin-de-siècle, le Chat Noir, Aristide Bruant, Yvette Guilbert et cie. La prolixité est la véritable richesse : les critères littéraires sont renouvelés, il ne s’agit plus de « littérature », mais bien de sensations. À l’hôpital, Verlaine aime les airs populaires : « Et l’on monte à la salle de chant. / Drôle, ça. / Comme qui dirait la concrétion, la synthèse, la quintessence du goût musical parisien populaire, la romance y domine », les chansons même « écorchées » : « Gestes faux comme la voix gutturale et traînarde à moins que fêlée, ô Paris ! ou alors terriblement méridionale ! Pataquès inouïs qui feraient douter si le chanteur comprend ce qu’il »envoie », terminaison en ô des rimes, à l’instar de quelques »artistes » de très infimes cafés-concerts, et ce, par chic, par un naïf, au fond, et quasi touchant dandysm… ô. » (Mes Hôpitaux, 3). Loin des cercles littéraires envahis de plus en plus par les universitaires, c’est le savoir-faire, et le savoir-se-faire-plaisir qui plait à Verlaine. De ce renversement des valeurs poétiques, le poète est conscient, mais il sait aussi qu’il n’a (plus) rien à prouver. Sans compromis, il compose. Il ne faut donc pas se demander pourquoi il fait cette poésie, mais comment il la fait.
Bien qu’il refuse le vers libre, Verlaine est incontestablement un moderne. Bien plus qu’on le dit. Il refuse le classicisme de la langue et de la syntaxe. Il ne recule devant aucune audace stylistique ou grammaticale, et cherche à enrichir la langue. Une raison de plus de le rapprocher de Villon. Une raison aussi de le rapprocher de Ronsard, de Desportes, de la Pléiade : jargons et patois, termes techniques, barbarismes, néologismes par dérivations, hispanismes, latinismes, anglicismes, etc, le lexique français, si pauvre, se voit gonflé. Syntaxe en origami, courts-circuits, déploiements ou concision, répétitions entêtantes (« …je jouis après des jours, des jours / Et des jours et des jours et des bonnes amours », Dans les limbes, VIII ; « Dans de hautes salles dans un littéral palais, se passèrent les semaines d’apprentissage. » Mes Hôpitaux, 1), la langue de Verlaine ne refuse rien. Et le moteur de cet enrichissement, la machine, c’est l’agencement rythmique. D’où, sans doute, cette fidélité au vers traditionnel, mesuré, cadencé. Certes son appartenance à la génération de 1840, l’âge donc, a joué dans le maintien du vers mesuré, mais il n’en reste pas moins que ce vers est une machine qu’il faut détraquer. Ce cadre, si peu rigide qu’il est devenu chez Verlaine (à la suite de Hugo), fonctionne comme un orgue. Question de tuyauterie : certains courts, d’autres plus longs, que l’on scie, que l’on remonte, et un souffle que l’on module pendant l’expulsion. Quelque chose de l’orgue de barbarie, déréglé.
Verlaine nourrit la langue, et nettoie du même coup la morale. Il est porté par un grand projet, qu’il construit sans plan pré-établi. Cellulairement a été sciemment démantelé (d’où l’étrangeté du choix des éditions Gallimard), au profit de ce projet que Verlaine gardait – et alimentait : « Idées pour la 2e édition de Parallèlement : un dialogue entre éphèbes et vierges, à la Virgile : ce cadre me permettra les dernières hardiesses. Intitulé « Chant alterné ». Je grossirai le lamento sur L. L. [Lucien Létinois] dans Amour mais laisserai sans doute Sagesse tel qu’il est. De la sorte (car Parallèlement sera augmenté de 4 à 500 vers), les volumes de ma tétralogie, si j’ose parler ainsi de mon « élégie » en quatre parties, seront d’importance égale. » (Lettre à Cazals de 1889). Cette « tétralogie » est définie par la musique (le terme renvoie insensiblement à Wagner), c’est un grand œuvre, d’où découle une pensée profondément originale : il s’agit notamment de mettre sur le même plan la pornographie la plus crue et le mysticisme le plus exalté. Oui, Verlaine est bien plus moderne, bien plus décapant, bien plus riche qu’on ne le pense. Érotisme, volonté d’un grand œuvre, refus des finalités (« Nulle conclusion à tirer de là comme des trois quarts de toutes les remarques, n’est-ce pas ? » Mes Hôpitaux, 3) : déjà du Bataille. La sexualité, qui est au cœur de l’œuvre (musique érotique) permet d’atteindre une intensité qui ne peut pas être « rapportée » par le texte (qui n’est qu’une trace, une recension), à moins qu’il soit impersonnel et musical. Dans cette expérience sexuelle, l’autre, quelque soit son sexe, est Dieu : « Ô ma femme, qui recevras mon souffle ultime ! » (Dans les limbes, IX) ; « C’est fait, littéralement je t’adore ! / On adore Dieu, créateur géant. / Or ne m’as-tu pas, plus divine encore, / Tiré de toutes pièces du néant ? » (Dans les limbes, XIV) ; « Je fus mystique, et je ne le suis plus, / (La femme m’aura repris tout entier) » (Chansons pour elle, XXV) ; « Gland, point suprême de l’être » (Hombres, XIV). En ce sens, la primauté de l’anecdote, c’est le refus de la sublimation. Le vil, le sale, le répugnant équivalent le noble, le sublime, le beau. Attraction et rejet du dandysme (selon la définition qu’on lui prête). Le crime, le repoussant, « l’infernal » de Baudelaire, de Barbey d’Aurevilly, de Huysmans (qui le fait connaître à un public élargi en 1884 avec À Rebours). Pour Verlaine, la religion ne se pratique plus sur le mode d’une transcendance, mais selon la purgation des passions, comme une hygiène.
Mais tout cela a été éclipsé. La postérité de Verlaine (la réception de l’œuvre d’après 1884) subit les deux grands mouvements de la première moitié du XXe siècle. Le néo-classicisme et le Surréalisme.
Au XVIIe siècle, avant même les années 60, la littérature pâtit d’une contre-révolution : après la Pléiade, Malherbes censure, biffe, épure. Boileau applaudit, Vaugelas renchérit. S’ensuivent deux siècles d’anémie. Jusqu’aux Romantiques (certains d’entre eux, du moins). Il en va de même après les Décadents et les Symbolistes. Contre l’excessivité, un retour à l’ordre est promulgué : le néo-classicisme porté par l’école Romane de Mauréas et Maurras se prolongera toute la première moitié du XXe siècle, de Gide à Anna de Noailles, de Gregh à Dorgelès. Clarté d’un vers traditionnel, refus des images bizarres et alambiquées, respect d’une langue grammaticalement correcte, pour soutenir une pensée « humaniste », parfois lourdement nationaliste. De l’autre côté, le Surréalisme préfère, de cette époque, Rimbaud et Lautréamont. Le goût du sale et du vil répugne à Breton qui, à la suite des Romantiques, n’encense que le sublime. Le Verlaine des années 80 et 90 devient donc confidentiel…
Conclusion
Lire les derniers recueils de Verlaine, contre les idées reçues, et contre cette image galvaudée qu’on véhicule encore d’un « Verlaine impressionniste ». Et voir chez Verlaine, accueilli par l’excellent peintre Jan Toorop en Hollande, et le poète Arthur Symons en Angleterre, sinon le précurseur, du moins un jalon de la « modernité ».
Voir aussi qu’il avait cette exigence d’abondance et de « babélisme », cette gouaille et ce bagout dans le récit, que l’on retrouve chez Jude Stéfan et chez Guy Goffette.
Voir enfin en lui un précurseur d’Ezra Pound et de Joyce, et, quoique sans filiation directe peut-être, de ces poètes qui mêlent différentes langues et langages dans leurs poèmes, Amelia Rosselli ou encore Michele Sovente disparu en 2011. Certainement Verlaine appartient à ce mouvement qu’il serait enrichissant de retracer, baroque, qui évolue, parfois confondu, avec un classicisme qui ne fait qu’entériner des extravagances bienvenues. Et Retrouver cette audace, en français, dans tous les français du monde.
La langue crue de Verlaine

Verlaine méprisé
La publication chez Gallimard de Cellulairement (choix étrange puisque ce projet de recueil avait été abandonné par le poète et que d’autres recueils publiés de son vivant n’apparaissent toujours pas dans cette collection de référence), précédé de Mes prisons, et l’exposition consacrée à Verlaine au Musée des lettres et manuscrits de Paris (Verlaine emprisonné, du 8 février au 5 mai 2013), sont-elles les marques d’une réhabilitation de la seconde période de l’écrivain ?
Pas encore tout à fait, mais elles ouvrent une brèche.
Tout le monde connait les Poèmes saturniens (1866), les Fêtes galantes (1869), La Bonne chanson (1872), Romances sans paroles (1874), et même Sagesse (1880) ou Jadis et naguère (1884), mais qui lit Chansons pour elle (1891), Liturgies intimes (1892), les géniales Élégies et les Odes en son honneur (1893), Dans les limbes (1894) ou encore Chair (1896) ? Il suffit de parcourir les déplorables notices de Jacques Borel pour le volume des œuvres poétiques complètes de La Pléiade pour comprendre le mépris qui pèse sur plus de la moitié des créations d’un poète pourtant illustre. Et pourquoi ?
C’est en 1938 que paraissent dans la Bibliothèque de La Pléiade les œuvres poétiques complètes (1), sous la direction de Yves-Gérard Le Dantec, que Jacques Borel vient donc réviser et compléter en 1962 après la publication des études sur l’œuvre et la vie de Verlaine de Jean Richer, Georges Zayed, V. P. Underwood et surtout d’Antoine Adam. Dans la très belle biographie d’Adam, aucun jugement moral, aucun mépris pour la vie menée par Verlaine (juste un affreux « affreux » pour qualifier le recueil Hombres). Alcool, errance, clochardisation, brutalités, sexualité débridée, les virevoltes d’un homme qui n’a jamais cherché à s’épargner, ou qui n’y est jamais vraiment arrivé, ne sont jamais condamnées. Le jugement vient des critiques de seconde zone. C’est une constance : Jorge Semprun n’éreinte-t-il pas Banville dans son introduction à l’anthologie de la poésie française du XXe siècle publiée chez Gallimard ? Thuriféraires de la norme et de la morale. Et ça vous condamne tout un pan d’une œuvre selon des critères douteux. Car pourquoi le second Verlaine est-il méprisé ? Parce qu’il déroge définitivement aux règles de bienséance.
Hypocrisie assurément : ce qui ne parle plus de Rimbaud, ce qui n’a pas été écrit à son contact, n’a plus qu’une qualité médiocre. Après Parallèlement – qui déjà démontre pour certains la décadence poétique de Verlaine -, plus rien n’est valable. Les poèmes chrétiens trouveront peut-être, par leur sujet, un peu de tolérance, quoique condescendante, chez les littérateurs bigots. Mais le reste est une pitoyable déchéance. Par exemple, pour les Odes en son honneur : « Pris dans la gangue de l’anecdote, cet amour, cette pitié ne passent pas du plan de la réalité décrite, identifiable, à celui de la vérité poétique. » (p.762). Pour les Élégies : « Le dessein, – ancien déjà, – du poète était de retrouver frémissante de l’élégie tibullienne : à cette volonté de simplicité, la vulgarité, le prosaïsme constamment font échec. » (p.784). Mêmes mauvaises notes distribuées pour Dans les limbes ou Chair : « …une veine épuisée déjà dans les derniers recueils de même inspiration, qu’à peine peut-on appeler érotique, tente en vain de survivre. » (p.881).
Avec l’homme s’abime la poésie. Avec la déchéance morale, la déchéance poétique. Et puis, l’érotisme doit rester un genre particulier, confidentiel, avec je-ne-sais-quoi de charmant et de mignon (L’une avait quinze ans, l’autre en avait seize…). Femmes (1890) et Hombres (1903), les deux recueils pornographiques n’ont été ajoutés à La Pléiade qu’en 1989 ! « La vérité poétique »… ? En quoi consisterait-elle ? Jamais on ne nous l’expliquera… mais on comprend qu’il faut qu’elle soit propre comme un intérieur bourgeois.
Or quelle vérité trouvons-nous dans les recueils de Verlaine ? Une sans concession : la crudité.
« Moi : D’accord, combien veux-tu ? Toi : Tout ce que t’as sur toi, / Chez toi, chez moi plutôt. Moi : Prends. Toi : Donne. Moi : Voilà, chère. Toi : Et maintenant faisez le beau, baisez mémère. » (clôture élégie VIII) « Use de moi, je suis ta chose » (Odes en son honneur, I) ; « Gland, point suprême de l’être » (Balanide II, Hombres) ; « Un peu de merde et de fromage / Ne sont pas pour effaroucher / Mon nez, ma bouche et mon courage / Dans l’amour de gamahucher. » (VIII, Hombres).
Crudité de la langue, pour ce goût de langue crue à pleine bouche. Nous pourrions aussi invoquer Artaud et parler de « cruauté » : pas de différence entre la vie et la littérature, pas de jeu superflu (« … cette espèce de poème / Que nous vivons… », XII, Élégies), le poème est une « ode », une « chanson », il est un chant et une imprécation, il est une prière et une requête, il doit agir sur la réalité quotidienne.
Mais s’arrêter à cela serait insuffisant : la nuance est encore là, mais sans la fameuse « fadesse » verlainienne : « Et dis à tes cheveux de me luire moins noir, / Tes cheveux, pourpre en deuil sur le rouge du soir. » (p.788). C’est incendie, révolte, révolution. Dans le lit d’hôpital, dans le délassement après le coït, la tension se manifeste dans la langue : écrire des mots – les prononcer – c’est encore agir, et transformer.
Car chez le bientôt royaliste conservateur (après avoir sympathisé assez avec la Commune pour y participer) n’en reste pas moins l’ennemi du bourgeois de la IIIe République, celle qui – pas mieux (ni pire) que les autres – s’assura sur le massacre des Communards. Comme Huysmans, Verlaine, malgré des propos souvent révulsants(2), fustige le bien-pensant : « À mon âge, je sais, il faut rester tranquille, / Dételer, cultiver l’art, peut-être imbécile, / D’être un bourgeois, poète honnête et chaste époux, / À moins que de plonger, sevré de tout dégoût, / Dans la crapule des célibats innommables. » (Ouverture des Élégies). Renversement des valeurs : c’est le célibat qui est « crapuleux », c’est-à-dire « malhonnête » ; il est malhonnête d’être « sevré de tout dégoût », d’être sans passion, sans lymphe. C’est cette appétence, ce désir d’intensité qui guide l’homme et tord la syntaxe. « Prompt à jouir, prompt à souffrir, / Prompt vers tout, hormis pour mourir ! » (Odes en son honneur, I). L’appétit de vie est énorme, cette volonté de puissance que nourrit au même moment Nietzsche. Que ce soit par renversement des catégories sociales ou par celui des identités sexuelles, le poète, tantôt en soumission, tantôt en domination (souvent les deux à la fois), ne fait l’économie d’aucun sentiment, d’aucun danger. C’est cette virulence qui se manifeste plus puissamment dans les recueils d’après 1880 que l’on méprise encore.
Notes
1. Jusque-là c’est Léon Vanier puis Albert Messein qui s’étaient chargés de la publication des œuvres complètes, entre 1899 (premier volume paru en 1903) et 1929.
2. Notamment dans Voyage en France par un Français, 1880.
Léo Trézenik, Proses décadentes
Postface des Proses décadentes publiées par Les éditions Solstices
Lien ici vers le livre sur Solstices project

Petits poèmes de la vie moderne, Les Proses décadentes (1886) s’amusent des riens du quotidien, des objets et des gens, parfois avec une acerbité qui rappelle combien le mouvement décadent, sous des aspects ludiques ou légers, est fondamentalement révolté, voire révolutionnaire. Dada ne surgit pas ex nihilo…
Les années 80 voient le retour des Communards exilés (l’amnistie totale est obtenue en juillet 1880) ; l’action directe est revendiquée et appliquée : attentats en Allemagne contre Guillaume Ier, assassinat même du tsar Alexandre II en Russie le 13 mars 1881 !
Ces années de gestation précèdent en France la période des attentats anarchistes (que l’on fait commencer en 1892) qui culminera avec l’assassinat du président de la République, Sadi Carnot, le 24 juin 1894 à Lyon où une plaque et une dalle au sol commémorent l’événement. Sante Geronimo Caserio sera guillotiné le 16 août 1894, un peu moins d’un mois avant ces vingt-et-un ans ; les lois scélérates seront promulguées le 11 décembre (Vaillant, pour venger Ravachol, lance sa bombe dans l’hémicycle du palais Bourbon le 9).
Ces révoltes politiques sont préparées par des révoltes de mentalité. Les écriteaux, Le dimanche fustigent la petite bourgeoisie non seulement ennuyeuse et ennuyée, mais surtout soumise à des contraintes sociales, culturelles et institutionnelles absurdes. Pas de pitié, chez Trézenik, pour cette servitude volontaire.
Contre ces figures bourgeoises, Le Cocher d’omnibus, sa « jolie trogne », sa réappropriation fougueuse du quotidien, son plaisir d’effrayer le timoré ; Le monde de l’enfance aussi, sa naïveté amorale.
À Rebours est publié en 1884, Les Déliquescences d’Adoré Floupette (recueil parodique) en 1885. C’est en 1884 aussi que le poème d’une génération, « Langueur » (Je suis l’Empire à la fin de la Décadence…), paraît dans Jadis et Naguère. « Bathylle, as-tu fini de rire ? », rire jaune ou rictus (Corbière). Détachement ou sarcasme. Les Proses décadentes poursuivent cette tendance, mais offrent un premier retour sur le courant lui-même : « Il n’y a pas plus décadence, aujourd’hui, qu’il n’y eut décadence alors qu’à l’Art classique s’essaya à succéder le romantisme ». Le terme est redéfini : décadence n’est plus un terme péjoratif, il ne vient pas signifier la perte de qualité, l’amoindrissement intellectuel ou esthétique d’une génération par rapport à la précédente. D’abord ironique et négatif sous la plume d’Henri Beauclair et Gabriel Vicaire (les auteurs des Déliquescences d’Adoré Floupette, poète décadent), il est chargé positivement par ceux qui se réclament d’une esthétique nouvelle. Ce n’est pas une perte, mais pas une perte mais un déplacement : goût pour le bizarre, le hors-norme, l’extravagant, l’inhumain, par rapport au Positivisme, aux académismes, à la démocratie en tant que force du nombre (contre les particularités individuelles).
C’est en cela que les Proses décadentes sont décadentes au-delà du seul titre. Et cet esprit (cette mentalité) s’informe dans la facture : le style agrammatical, dissonant, les barbarismes, les néologismes, les expérimentations en tout sens. Dérivations grammaticales (dont beaucoup d’adverbes) : « sapidement », « rimaillairds », « morphinisme » (Préface) ; « nickellement », « affriolance », « chavireur » (De l’adultère où le mot « adultère » est lui-même au féminin) ; « rubanesque » (Bégaiements) ; « rembranesque », « ravissamment » (Les Humbles) ; « cascadante », « mendieurs », « sculpturalement » (La Troubleuse d’hommes) ; « sphinxisme », « bouffements » (Au déduit) ; « méprisamment » (Le Chien bibelot), « confiamment » (Jeux d’enfants), « susciteurs » (L’Art de rompre), « cinglement » (Tendresse) ; « s’échevellent », « se divisionne », « frient » (le verbe « frire » est défectif : il ne se conjugue qu’au singulier), « cataractant » (Philosophie inodore) ; « subodorante » (Les écriteaux), « s’apoplectisaient » (Ma canne) ; « troussement », « poudrederizées », « tourbillonneurs » (Ceux qui dansent) ; « buccalement » (Conseils), « haut entalonnées » (Derniers mollets).
Argot, barbarismes, néologismes : « sergots » pour « policiers », le fautif et farfelu « rhytmique » (on a vu « rhythmique », avant la correction étymologique actuelle « rythmique ») dans Bégaiements ; « s’estomireront » (Les Humbles, Le bon Dieu : verbe médialisant, utilisé par Balzac dans Les contes drôlatiques et repris par plusieurs auteurs « fin-de-siècle » dont Cazals – l’ami de Verlaine – et Gustave Le Rouge par exemple) ; le moderne « pressensation » (Au déduit ; on écrit aujourd’hui « pré-sensation ») ; l’élision « lorsqu’aura paru » (L’Art de rompre) ; « enlangé » (L’épouvanteur d’enfants), « éclis » (La Marguerite ; que l’on trouve dans Lourdines de Chateaubriand, pour « éclisse ») ; « cholérifères », « enfantelet » (Le chien est le meilleur ami de l’homme), « guères » (orthographe vieillie, dans Les écriteaux).
La phrase sait se faire courte, elliptique, nerveuse. Concision sans étalage. Ce qui peut paraître comme des affections, ou des effets superfétatoires, est nécessaire au dessein de l’auteur, et c’est cette structure ramassée qui le prouve le mieux. On s’éloigne de la phrase quotidienne, de cette phrase sociale et institutionnelle qui pense pour nous. Soit encore elle est déformée (toujours la violence), soit encore elle appartient à l’enfance : la répétition de certaines phrases évoque la chanson, ou mieux : le conte (Le chien l’ami de l’homme, Les Humbles…) en vogue, du reste, à cette époque (Villiers, Laforgue, Allais, etc).
Cette fougue déborde jusque sur la typographie, c’est-à-dire sur l’utilisation (et le détournement) des moyens industriels de mise en forme du média : usage de l’italique, de la majuscule, des tirets, etc. Les effets visuels altèrent l’utilisation classique du livre (de l’écrit en général) et orientent la lecture. Le coup de dés paraît en 1897…
Léo Trézenik va plus loin : mise en abyme (avec un effet proleptique – et une conscience très moderne de la focalisation) de « ceux qui regardent danser » dans « ceux qui dansent », à laquelle se rajoute un degré dans l’abyme avec celui qui regarde ceux qui regardent danser. Celui-là est le double de l’écrivain. La vision est toujours déplacée, déformée. Tout se concentre sur la conscience, la prise de conscience. Conscience du jeu littéraire, tant dans la technique que dans les thèmes abordés. Ces thèmes, classiques depuis longtemps, sont alors exploités jusque dans leur retranchement : la morte amoureuse, le satanisme, la femme fatale… Le portrait tourne à la caricature : l’écrivain est caricaturiste, entre humour et sarcasme.
Car l’humour, bien sûr, plane sur toutes ces proses. Humour très Alphonse Allais de Le bon Dieu (on pense irrésistiblement aux Monty Python), même si Allais n’est publié pour la première fois qu’en 1883 dans Le Chat noir (dont il deviendra le directeur en 1886), et que son premier recueil, À se tordre, ne paraît qu’en 1891. Humour rarement potache (que l’on retrouve ailleurs chez Trézenik, sous le pseudonyme de Pierre Infernal, dans La Journée d’un carabin par exemple), mais plutôt noir (Faits divers) et, oui, souvent sarcastique (Tendresse, Mardi gras). Mais humour doux-amer aussi, notamment par la note nostalgique du final : les Derniers mollets, ce sont les derniers mots, les dernières notes.
Monde de sensations, monde mobile et changeant, fait de faux-semblants et de modifications continuelles de perspective (Au déduit). Car plus que des impressions, c’est une littérature des sensations : la matière avant la pensée. Une libération. S’il fallait défendre les mouvements fin-de-siècle face aux classiques qui en critiquent les extravagances de langue, les déséquilibres, les lourdeurs, nous invoquerions non seulement ces extravagances, ces déséquilibres, ces lourdeurs qui font de la langue une pâte brute, un latin de bas-empire, mais aussi les libérations qu’a engendré cette langue byzantine : attention portée à ce qui jusque-là était caché, rebuts et bassesses, objets banals, pulsions mortifères, questions de sexualités (de « genres » déjà), fétichismes, qui préfigurent la psychanalyse autant que les introspections proustiennes (après Laforgue ou Dujardin), les libertés dadaïstes et surréalistes, et même, plus loin, les expériences de Georges Bataille (Bégaiements où, bien avant tout le monde, Trézenik parle de la sexualité de l’enfant). L’étrange hypotypose allégorique (De l’adultère) qui ouvre ce livre confère une importance particulière aux objets : plus qu’un appel au merveilleux (cette intrusion dans le réel du fantastique), la mécanique de l’objet en fait une prolongation du moi projeté (sur-moi) et de la conscience.
Léo Trézenik n’a peut-être pas eu d’influence directe sur les auteurs ou sur les courants du XXe siècle (il n’est pas souvent cité) à l’aulne desquels nous construisons la mémoire littéraire d’une époque. Mais peu importe : il est symptomatique de la période que nous nommons « fin-de-siècle » qui renvoie à ces années de transformation de la société française (pour ne pas s’embarquer trop loin) sur le plan industriel, politique (la République s’entérine), et culturel (l’école pour tous, ses programmes, son rythme, remodèle en profondeur la vie quotidienne et les mentalités). Le fondateur des Hirsutes a sans aucun doute contribué à divulguer cet esprit acerbe, créatif, libérateur, qui qualifie pour nous le dernier quart du XIXe siècle.
Michele Sovente : notes sur le plurilinguisme et quelques adaptations en français
2
Per vacuum
(Acrostico di Emilio Tadini)
Erumpit febris vivendi vel
Malum urbis hoc est Mediolani
Instanter clamantis in deserto una cum
Larvis quae sese sauciant sine
Indulgentia dum per fractas
Orbitas fendunt machinae vacuum.
Tot putrescentes lunae tot tumescentes
Animae vel figurae miliens
Dividunt dies de noctibus et coniungunt
Infimas voces cum simulacris
Nequitiae dum fractae vitae sine
Indulgentia per vacuum labuntur.
4
Per il vuoto
Erompe la febbre del vivere che è
Male, urbano cioè di Milano
Inesorabilmente urlante nel deserto con
Larve che si aggrovigliano ulcerandosi senza
Indulgenza mentre per sfasate
Orbite tranciano il vuoto le macchine.
Tante putrefatte lune tante tumefatte
Anime o figure mille volte
Dividono i giorni dalle notti e uniscono
Infime voci con i simulacri della
Nequizia mentre sfasate vite senza
Indulgenza sciovalano nel vuoto.
7
P’ ‘u vvacanto
Èsce fòra ‘a frèva ‘i campò
Malo ‘i cittò malo ‘i Milano fravecata
‘Int’ a nu deserto ‘i pullecenèlla fàvuze
Luntano r’ ‘i ccòse bbòne senza
Indurgenza tramènte ca pe’ ombre vecchie e
Ombre nòve stracciano ‘u vvacanto ‘i mmàchine.
Tanta lune ammarciute tant’aneme
Ammaccate ‘nziéme cu fiure mille vòte nun
Danno cuórpo û tiémpo e fanno ‘ncuntrò
‘I vvóce cchiù ‘ntussecóse cu ‘i cchiù
Nire vulìe tramènte ca vite sfrantummate senza
Indurgenza p’ ‘u vvacanto rruciuléano.
*
Adaptation en français
À travers le vide
(Acrostiche pour Emilio Tadini)
Eclate la fièvre de vivre le
Mal de la ville ou plutôt de Milan
Inexorablement hurlant dans le désert avec des
Larves qui s’agglomèrent en s’ulcérant sans
Indulgence tandis que selon des déphasages d’
Orbites les voitures tranchent le vide.
Tant de lunes putréfiées tant d’âmes
Abimées ou des milliers de figures
Divisent les jours des nuits et unissent d’
Infimes voix avec les simulacres les plus
Noirs pendant que les vies déphasées sans
Indulgence roulent dans le vide.
*
Quelles sont ces voix de Michele Sovente ?
Cette polyphonie échappe encore au lecteur français.
Sans s’appesantir sur l’incuriosité, d’autres motifs : s’il faut avancer une hypothèse parmi d’autres, on invoquera le Classicisme (Malherbes, Boileau !) qui a déprécié un langage de la diversité (celui de la Pléiade) : la volonté d’une unité nationale réclamait une esthétique aplanie (la pensée de l’unité restreint le langage).
Nous en sommes encore là sans doute.
Et nous lisons avidement Franciscae meae laudes de Baudelaire, les décapants Jadis et Naguère (1884), Parallèlement (1889), Élégies (1892) ou encore Mes Hôpitaux (1891), d’un Verlaine qu’on méconnait ; les poètes néo-latins, de toute époque, comme une terra incognita ; l’auteur expatrié des Cantos (chants de Babel !), Ezra Pound ; et Amelia Rosselli, et en Italie toujours, Michele Sovente… Et nous savons qu’il y en a d’autres…
Car la situation italienne a bénéficié de certaines contingences : la volonté d’indépendance des villes, par exemple, qui ne s’estompa que tard – dans les volontés politiques – et essentiellement avec les révolutions industrielles qui instauraient de nouvelles vitesses, favorisa des littératures dont les mots intriguent et éblouissent. Richesse des vocabulaires, richesse des visions. Toutes les modernités, toutes les influences virent gonfler le flux des voix – jusqu’à l’italien national (il suffit de comparer nos dictionnaires).
Pasolini écrivit en frioulan. Amelia Rosselli écrivit en anglais, en français ainsi qu’en italien, traversée de formes dialectales et de néologismes. Michele Sovente, né en 1948 près de Naples, mort en 2011, publia Bradisismo en 2008 dont plusieurs sections comprennent des poèmes en trois langues : italien, latin, et un dialecte de Cappella, proche du napolitain.
Pour Sovente, ce sont des voix de terre : le latin sur le sol romain, le latin enterré, le latin lointain aussi ; l’italien par strates, ou plaques, encore, qui circulent par les migrations internationales mais aussi nationales (des familles, des populations se déplacèrent dans l’Italie de Mussolini) ; le dialecte, enfin ou d’abord, ancêtres, famille, fantasme, oui, mais dialecte aussi comme déviance, non-alignement, tangente. Des voix de laves (le Vésuve), des voix larvées qui resurgissent ici et là, parmi les scories. Le tombeau vendu de Virgile. Ces résurgences spatiales en parallèle aux époques : classicisme, baroque, modernisme, du sonnet au vers libre ; des voix pas même humaines, mais des vibrations, des ondes hertziennes, appréciables par magnitude, ou simplement avec un bâton de sourcier : tendre l’oreille, le bras, tendre tout entier.
Un bradyséisme, un lent mouvement de tectonique des plaques, des couches telluriques, qui enfle et dégonfle, qui respire aussi jusque dans nos corps, que produit la lecture (et la traduction) des poèmes. Les trois langues se croisent, s’enchevêtrent, et varient. Les différentes versions, les différentes variations composent des formes auxquelles on se connecte, qu’on connaisse ou non les langues, qu’on s’y familiarise, qu’on les compare par caprice. Traduire chaque version est une gageure un peu ridicule, un solipsisme : on a préféré une adaptation.
Rachilde : « Les cas particuliers »
Préface de Monsieur Vénus publié par Les éditions Solstices
Lien ici vers le livre sur Solstices project
.jpg)
Rachilde a fait une mauvaise fin. Plus, contrairement à ce qu’on insinue, à cause de son sexe, que pour ses opinions réactionnaires d’après-guerre. Car si elle était en effet anti-féministe, homophobe, nationaliste, belliciste, critiqua Proust, Gide, Dada et le Surréalisme, Céline – pour prendre un exemple célèbre – n’était-il pas bien pire encore ? Ne nous leurrons pas : c’est parce que Rachilde est une femme qu’elle est morte dans l’oubli en 1953, à 83 ans.
Quand paraît Monsieur Vénus, en 1884 (la même année qu’À Rebours de Huysmans, que Les Poètes maudits et Jadis et Naguère de Verlaine…), elle n’a que 24 ans. Une jeune fille, vêtue à la garçonne (elle obtient une autorisation préfectorale pour « se travestir »), libre dans son corps, dans son image, dans sa sexualité. Déjà beaucoup de raisons de publier Monsieur Vénus Rachilde, en espérant en publier beaucoup d’autres.
Et puis, comme le souligne Barrès, et comme cela est évident, parce que ce livre est extraordinaire (au sens propre du terme) : il traite du hors-norme. La révolte rachildienne préfère parler de hors-nature, titre d’une « étude de mœurs » publiée en 1887 (terribles années 80 !) : la nature créée par Dieu autant que par la vision de la Science et de la Société.
Aujourd’hui, la publicité des pratiques déviantes les a normalisées. On a perdu l’excitation ou la surprise de lire le comte de Charlus fouetté par un ancien domestique, Jupien, comme on sourit à peine de savoir que Héliogabale se faisait enculer par ses cochers, peut-être parce que son père était, semble-t-il, cocher. La diffusion de Sade, les bavardages autour des 120 journées, l’adaptation de Pasolini, une lecture savante, nous a définitivement insensibilisés. Puisqu’au texte s’ajoute l’image. Et certes, dans ce domaine, l’imagination est parfois surpassée par l’infinie réalité des pratiques.
Puisqu’il a autant de pratiques qu’il y a d’individus ; il y a autant de désirs qu’il y a de corps. Des monades, des myriades de sensibilités qui, alors même qu’elles le cherchent à peu près toutes, se rencontrent nécessairement au quotidien.
En fait, certainement on peut dire qu’il y a autant de sexes qu’il y a d’humains. La dichotomie homme/femme, valable d’un point de vue biologique (tant que la science n’a pas fait enfanter un homme – ce que la césarienne permettrait déjà de rendre possible), n’est pas valable, ou disons opératoire dans un monde social, c’est-à-dire dans un monde qui ne fonctionne pas qu’en abstractions, c’est-à-dire encore : dans notre monde à tous, tout le temps.
C’est cette variété que ne rend pas la mise en avant de quelques pratiques codées – surcodées – de manière grossière. La plupart de ceux qui s’y adonnent ne répondent au final qu’à des stimulis similaires à une publicité pour un fast-food ou pour une lessive.
C’est ce qui fait du livre de Rachilde un trésor. Même les symboles un peu lourd (« Raoule » pour le personnage féminin-masculin) effacent les velléités réalistes (dites alors « décadentes ») de ce récit pour en faire une pure expression des désirs, parfois – dans certaines fulgurances – des pulsions.
Cultiver les goûts propres en dehors de toutes les pressions extérieures.
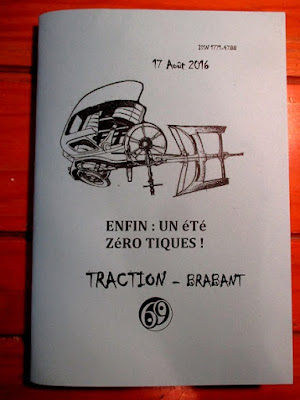
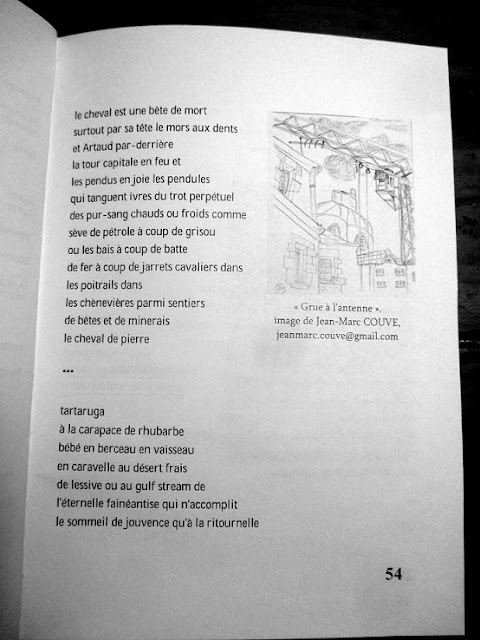
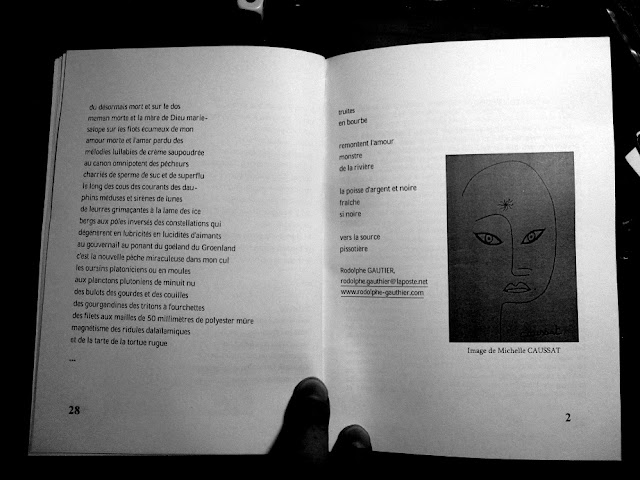



.jpg)


